 |
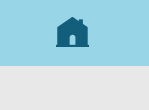 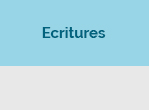   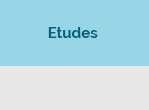  |
CONSIDÉRATIONS ÉPIGRAPHIQUES SUR L'EXPÉRIENCE DE L'ÉCRITURE NEPHITE FAITE PAR JANNE SJODAHL
John Gee Journal of Book of Mormon
Studies Vol. 10, 1, 2001,
p. 25
Deux questions se dégagent des caractères hébraïque que Henry Miller a tracés pour l'expérience de Janne Sjodahl sur l’écriture néphite. Un petit problème, c'est que Miller a utilisé les lettres hébraïques carrées plus tardives plutôt que les lettres hébraïques archaïques du temps de Léhi. Le type de caractères utilisé change quelque chose dans l'espace requis pour écrire l’échantillon de texte. Le problème majeur est cependant la taille des caractères utilisés, qui faisait une différence encore plus grande dans l'espace requis pour l’échantillon de texte. Pour le lecteur moderne, les caractères utilisés par Miller sont trop petits pour être faciles à lire. Les scribes de l'Antiquité auraient-ils utilisé des lettres aussi minuscules ? Un coup
d’œil rapide sur les manuscrits hébraïques écrits sur papyrus (dont la
plupart sont postérieurs à l'exil babylonien) montre que les lettres étaient écrites
beaucoup plus grand que celles rendues par Miller. Les documents sur papyrus étaient
écrits au pinceau et à l’encre et peuvent faire preuve d'une calligraphie
élégante. Mais les plaques d'or et d’airain étaient gravées et la gravure
implique des conventions différentes de celles de l'écriture au pinceau et à l'encre. Nous avons
aujourd’hui suffisamment d’échantillons d'écriture hébraïque ancienne sur
des objets retrouvés pour examiner la question des caractères hébraïques gravés de
l'époque de Léhi. Quand on publie des dessins ou des photos de textes écrits sur ce
genre d'objets, on les agrandit habituellement
deux ou trois fois pour les rendre plus lisibles. J'ai mesuré la taille véritable des
lettres sur une série d'objets gravés et sur la base des mesures fournies par la
documentation. Les caractères utilisés autrefois ont à peu près la même taille que
ceux utilisés par le scribe de Sjodahl. Contrairement à notre façon de concevoir la
lisibilité, l’écriture hébraïque de Miller convient parfaitement au test pour
lequel Sjodahl l’a utilisée. L’échantillon
d'écriture que j'ai utilisé dans le tableau en annexe est tiré de deux publications
récentes (j’aurais pu en utiliser d'autres sans changer le résultat) qui donnent
des illustrations de sceaux, de bulles et de poids anciens sur lesquels sont gravés des
caractères hébraïques. Sept objets proviennent de la collection Moussaief et
apparaissent dans un livre de Robert Deutsch 1. D'autres lettres
apparaissent sur un poids en pierre (le « poids Kollek ») dont traite un article de
Michael Heltzer 2. Les objets ont été choisis de manière à
couvrir l'alphabet tout entier. Toute l'écriture vient des trois siècles précédant
immédiatement le départ de Léhi de Jérusalem. Les lettres de
l'article publié par Sjodahl en 1927 ont une moyenne d'environ 1,5 mm². Le tableau
ci-dessous montre, en millimètres, la taille des caractères figurant sur les objets
anciens. Dans le tableau, nous avons utilisé les équivalents hébraïques ultérieurs,
que certains lecteurs reconnaîtront, plutôt que les caractères archaïques). La taille
des lettres varie d'un objet à l'autre, mais elle se situe en gros dans la fourchette des
1-3 mm². Les réalités épigraphiques de la taille des caractères jettent une lumière
nouvelle sur la réflexion de Jacob concernant « la difficulté de graver nos paroles sur
des plaques » (Jacob 4:1) et sur le regret de Moroni que « nous ne puissions écrire que
peu à cause de la maladresse de nos mains » (Éther 12:24).
1 Considérations épigraphiques sur
l'expérience de l'écriture néphite faite par Janne Sjodahl Robert Deutsch, Messages
from the Past: Hebrew Bullae from the Time of Isaiah Through the Destruction of the First Temple, Shlomo Moussaieff Collection and an
Up-to-Date Corpus (Tel
Aviv, Archaeological Center Publications, 1999). 2 «A New Weight from Hamath and Trade Relations
with the South in the Ninth-Eighth Centuries BCE”, dans The World of the Aramaeans
II, dir. de publ. P. M. Michèle Daviau, John W. Wevers et Michael Weigl, Sheffield,
Sheffield Academic Press, 2001, pp. 133-135.
|
|
