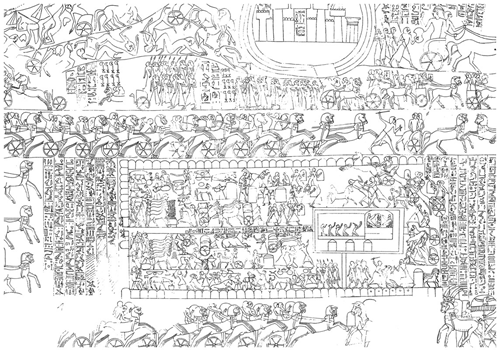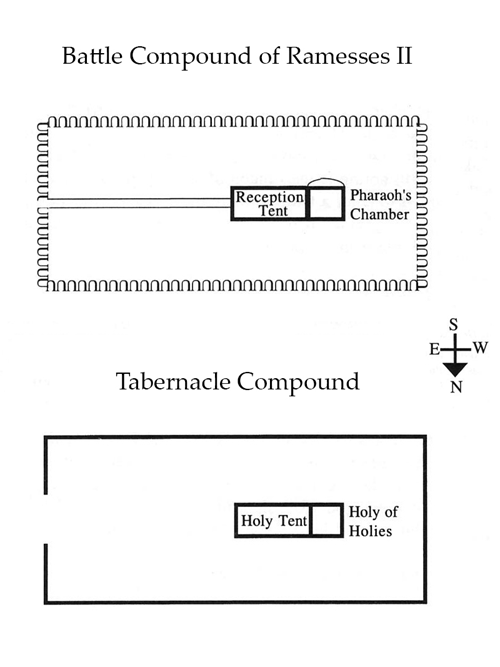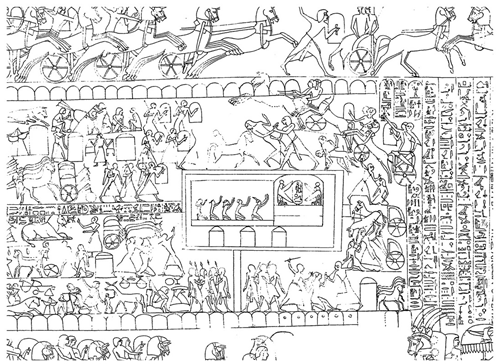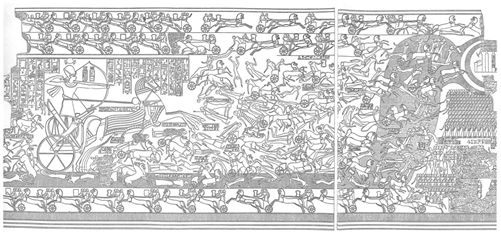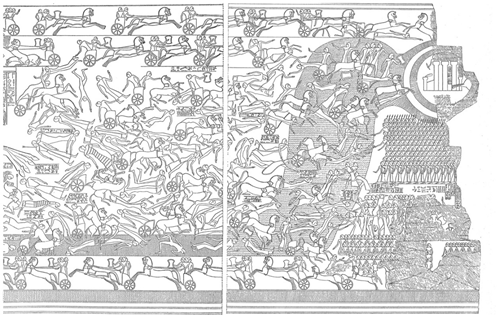|
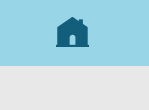 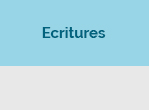   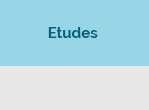  |
|
Y a-t-il eu un Exode ?
Beaucoup de gens sont certains que l’un des événements centraux du
judaïsme ne s’est jamais produit.
Il y a cependant des indices, dont
certains sont publiés ici pour la première fois, qui donnent à penser le
contraire.
Essai
2 mars 2015
À propos de l’auteur
Joshua Berman enseigne la Bible à l’université Bar-Ilan et aux facultés
universitaires de Shalem en Israël et est chercheur à l’Institut Herzl.
À ce jour, aucun discours en chaire par un rabbin américain contemporain
n’a généré une plus grande attention ou plus de controverses qu’un sermon
prononcé par le rabbin David Wolpe le matin de la Pâque 2001. « La vérité,
a-t-il dit à son assemblée de Los Angeles, est [que] la façon dont la
Bible décrit l’exode [d’Égypte] n’est pas la façon dont cela s’est passé,
si cela s’est passé. »
En plus de lancer un pavé théologique, ce sermon inaugurait une nouvelle
ère, une ère au cours de laquelle les Juifs fréquentant la synagogue
pouvaient s’attendre de plus en plus à être confrontés aux constatations
des études scientifiques de la Bible. Pour le rabbin Wolpe, l’honnêteté
intellectuelle exigeait que, en ce qui concerne l’Exode en particulier,
ces constatations non seulement s’imposent mais soient adoptées, et il
était du devoir des leaders spirituels comme lui d’aider
les fidèles à les assimiler.
Au cours des années qui ont suivi, grâce en grande partie à l’Internet et
à l’omniprésence des médias sociaux, l’exposition à ces constatations a
augmenté exponentiellement, dont une grande partie concentrée sur un
point : l’historicité ou surtout la non-historicité de l’exode biblique.
Par exemple, dans un
essai inaugural
pour The Torah.com, un site consacré à « l’intégration de l’étude de la
Torah aux disciplines et aux constatations des recherches scientifiques
bibliques », Rabbi Zev Farber déclare catégoriquement que « compte tenu
des données auxquelles les historiens modernes ont accès, il est
impossible de considérer les récits d’exode massif hors d’Égypte [ou] ce
qui s’est passé dans le désert... comme historique. »
On pourrait être tenté de demander : Où est le problème ? Pour certains,
en effet, il n’y en a pas : admettre qu’il n’y a jamais eu d’exode est une
question de simple honnêteté et ne devrait guère avoir d’effet délétère
sur l’opinion que l’on a du judaïsme. Au contraire : les histoires de la
Bible, nous dit-on, nous parlent en termes symboliques ; la voix de Dieu
est dans le message de l’histoire de l’exode, pas dans les faits
supposés, et ce message, une fois dépouillé de son bagage mythologique,
n’en est que renforcé.
Cependant, pour d’autres, exciser l’exode du judaïsme c’est saper le
judaïsme lui-même. Après tout, la justification biblique de l’obligation
d’Israël vis-à-vis de Dieu est fondée non pas sur son identité en tant que
Créateur ou sur son autorité morale suprême, mais sur le fait que les
esclaves israélites en Égypte ont crié vers lui du fond de leur esclavage
et qu’il les a sauvés. C’est l’unique moteur derrière les premières lignes
des dix commandements: « Je suis l’Éternel, ton Dieu qui t’ai fait
sortir d’Égypte, de la maison de servitude. »
Selon ce dernier point de vue, s’il n’y avait pas d’exode, la
quasi-totalité des textes sacrés du judaïsme au cours des siècles auraient
perpétué un gros mensonge. En réponse à la question posée par l’enfant
lors du repas du seder : « En quoi cette nuit est-elle différente de
toutes les autres nuits? » le père serait obligé de répondre : « En
réalité, mon enfant, il n’y a pas de différence. » Et en effet, à de
nombreuses tables contemporaines du seder, une nouvelle figure est
apparue : à côté du fils qui ne sait pas comment le demander se trouve le
père qui ne sait pas quoi répondre.
Dans ce qui suit, je propose au père trois cuillerées de science pour
l’aider à formuler une réponse.
I. Y a-t-il eu un exode ? Passage en revue des arguments
L’argument contre l’historicité de l’Exode est bien simple et peut être
résumé en cinq mots : une absence totale de preuves. On ne trouve nulle
part dans les écrits de l’Égypte ancienne la moindre mention explicite
d’esclaves hébreux ou israélites et encore moins d’un personnage nommé
Moïse. Il n’est question nulle part de transformation des eaux du Nil en
sang ou d’une quelconque série de plaies correspondant à celles de la
Bible ou de la défaite d’un quelconque pharaon à l’échelle proposée par le
récit de la Torah de la noyade massive des forces égyptiennes dans la mer.
En outre, la Torah dit que 600 000 hommes âgés de vingt à soixante ans ont
quitté l’Égypte ; si on y ajoute les femmes, les enfants et les personnes
âgées, on arrive à une population d’environ deux millions d’âmes. Il n’y a
nulle part la moindre preuve archéologique ou autre d’un ancien campement
de cette taille dans le désert du Sinaï pas plus que la moindre preuve
qu’un aussi grand afflux se soit produit plus tard à un moment quelconque
dans la terre d’Israël.
Ce sont là des faits qu’aucun
chercheur ou archéologue compétent ne niera. La cause est entendue alors ?
Pour ceux qui voudraient défendre la plausibilité d’un exode historique,
quelle réponse possible peut-il y avoir?
Commençons par l’absence d’éléments de preuve de l’existence des Hébreux
dans les documents égyptiens. Il est tout à fait vrai que ces documents ne
contiennent pas de mentions claires et non équivoques d’ « Hébreux » ou d’
« Israélites ». Mais cela n’a rien d’étonnant. Les Égyptiens appelaient
tout simplement « Asiates » tous leurs esclaves sémites de l’ouest, sans
distinction entre les groupes — tout comme les propriétaires d’esclaves
dans le nouveau monde n’identifiaient jamais leurs esclaves noirs par
l’endroit d’Afrique d’où ils venaient.
Plus généralement, il y a une limite à ce que nous pouvons attendre des
écrits de l’Égypte ancienne. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des papyri
qui y ont été produits au cours de la période en question ont été perdus
et il n’y en a absolument aucun provenant du delta oriental du Nil, la
région où la Torah affirme que les esclaves hébreux résidaient, qui ait
survécu. Au lieu de cela, nous devons recourir aux inscriptions sur les
monuments, qui, étant principalement des rapports aux dieux sur les
réalisations royales, sont loin d’être complètes ou fiables en tant que
documents historiques. Elles ressemblent davantage aux curriculum vitae
modernes et brillent tout autant par l’absence d’échecs quelconques.
Nous aurons des raisons de revenir plus tard sur ces inscriptions.
Examinons pour le moment l’absence de preuves archéologiques explicites de
l’Exode. En fait, beaucoup d’événements importants rapportés dans
divers écrits anciens sont invisibles archéologiquement. Les migrations
des Celtes en Asie mineure, des Slaves en Grèce, des Araméens dans le
Levant — tous décrits dans des sources écrites — n’ont laissé aucune trace
archéologique. Et cela non plus n’est guère surprenant : l’archéologie met
l’accent sur l’habitat et la construction ; les migrants sont nomades par
définition.
Les données archéologiques sont tout aussi silencieuses en ce qui concerne
les nombreuses conquêtes dont l’historicité est généralement acceptée et
même de nombreuses batailles de grande envergure et importantes, y compris
celles qui sont relativement récentes. La conquête anglo-saxonne de la
Grande-Bretagne au Ve siècle, la conquête arabe de la Palestine
au VIIe siècle et même l’invasion normande de l’Angleterre en
1066 : toutes n’ont laissé quasiment aucun vestige archéologique. Est-ce
parce que la conquête est généralement accompagnée de destruction ? Pas
vraiment : les livres bibliques de Josué et des Juges, par exemple,
parlent d’une infiltration graduelle dans la terre d’Israël avec seulement
une petite poignée de villes déclarées détruites. Et ce qui est vrai de
l’Antiquité est vrai pour plusieurs périodes dans l’histoire militaire
dans lesquelles la conquête n’a entraîné en aucune façon une destruction
automatique.
Départ des Israélites1829, par le peintre écossais David Roberts.
Wikimedia.
Tant que nous en sommes à parler des preuves archéologiques, permettez-moi
aussi de régler la question de l’exode « massif » de deux millions
d’Israélites. Même si elle occupe une place importante dans le procès de
l’historicité de l’Exode, c’est un faux problème qui mérite qu’on s’y
attarde un peu. En fait, malgré la déclaration apparente de la Bible que
les hommes israélites étaient 600 000 quand ils ont quitté l’Égypte, il y
a une abondance d’éléments dans la Torah qui vont dans le sens d’un
nombre radicalement plus restreint.
Il y a déjà le livre de l’Exode (23:29-30), qui affirme que les Israélites
étaient tellement peu nombreux qu’ils étaient incapables de peupler
le pays dans lequel ils étaient destinés à entrer ; de même, en les
appelant le moindre de tous les peuples, le Deutéronome (7:7) dit qu’ils
étaient gravement dépassés en nombre par les habitants du pays. Le livre
des Nombres (3:43) signale que le nombre des premiers-nés Israélites
masculins de tout âge est de 22 273 ; pour qu’il y ait si peu de
premiers-nés masculins dans une population totalisant plus de deux
millions d’âmes, il faudrait un taux de fécondité de plusieurs dizaines
d’enfants par femme — un phénomène qui n’est pas mentionné par la Torah et
que l’on ne trouve nulle part dans aucun lignage familial de cette époque
dans d’autres sources du Proche-Orient antique.
En outre, il aurait fallu des jours pour traverser un campement de deux
millions de personnes — l’équivalent de la population de Houston (Texas).
Et pourtant la Torah (Exode 33:6-11) ne fait aucune réflexion non plus
là-dessus, décrivant plutôt les Israélites comme sortant régulièrement du
camp et y revenant sans aucune difficulté. Elle ne fait pas non plus la
moindre allusion au vacarme ni à la cohue qui auraient été créés par le
système de sacrifices centralisé imposé dans le Lévitique. En outre, dans
Exode 15:27, on nous dit que les Israélites campent dans une certaine
oasis du désert qui arbore 70 dattiers, qui, pour une population de deux
millions de personnes, auraient nourri et abrité 30 000 personnes par
arbre !
En fait, plusieurs détails de l’histoire de l’Exode semblent effectivement
refléter les réalités de l’Égypte ancienne. De plus, ce sont des détails
qu’un scribe vivant des siècles plus tard et réinventant l’histoire aurait
eu peu de chance de connaître.
Pourquoi le nombre de 600 000 hommes en âge de se battre est-il tellement
hors de propos par rapport à autant d’autres éléments du récit du désert
de la Torah ? Nous avons affaire ici à une particularité caractéristique
de toute la Bible. Si, d’une manière très générale, les dimensions et les
proportions qu’elle avance — comme celles données pour le Tabernacle dans
le désert ou pour le Temple de Salomon — sont tout à fait réalistes, les
exceptions se produisent presque universellement dans un seul domaine :
c’est l’armée, où l’on trouve des nombres atteignant des proportions
véritablement « bibliques ».
En hébreu biblique, comme dans les autres langues sémitiques, le mot qui
veut dire mille —eleph— peut aussi signifier « clan » ou
« troupe », et il ressort clairement des occurrences individuelles du mot
que ces groupes sont très loin d’être constitués d’un millier d’individus.
Dans un contexte militaire, le terme peut tout simplement fonctionner
comme une hyperbole — comme dans « Saül a frappé ses mille, et David ses
dix mille » (1 Samuel 18:7) — ou jouer un rôle typologique ou symbolique,
comme les chiffres 7, 12, 40 et ainsi de suite. Prise isolément, une liste
de recensement totalisant quelque 600 000 hommes désigne de toute évidence
un certain nombre d’individus ; au vu des autres données que j’ai
présentées ici, il devient difficile de dire ce qu’est ce nombre […].
Il est donc beaucoup moins surprenant qu’on pourrait le croire que
l’archéologie reste silencieuse sur le campement israélite et l’afflux de
population dans le pays. Après tout, la population n’a peut-être pas été
très grande.
À la lumière de ce que nous avons vu jusqu’ici,
faut-il toujours nier
l’historicité de l’Exode en raison de l’absence de preuves ? Ou
pouvons-nous maintenant invoquer la boutade bien connue et bien vraie que
l’absence de preuve n’est pas preuve d’absence?
En fait, il y a plus à dire que cela. Beaucoup de détails de l’histoire de
l’Exode semblent remarquablement refléter les réalités de l’Égypte de la
fin du deuxième millénaire, la période où l’Exode a pu le plus
vraisemblablement se produire —et
c’est le genre de détails
qu’un scribe vivant des siècles plus tard et réinventant l’histoire aurait
eu peu de chance de connaître :
Bien sûr, certains spécialistes affirment que des vestiges comme la stèle
de Mérenptah ne nous disent rien du tout sur un exode supposé, seulement
qu’il existait, en 1206 avant notre ère, une entité nomade nommée Israël
dans le pays de Canaan qui, pour autant que nous sachions, aurait pu être
un peuple autochtone. Par contre, d’autres, se basant sur la même stèle,
pensent que nous devrions dater l’exode des Israélites à une période
située peu de temps avant que l’inscription ne soit faite — à savoir, au
règne de Ramsès II.
On fait jouer ici un bond méthodologique qui combine les indices
archéologiques (l’inscription de Mérenptah) avec les éléments de preuve
bibliques (le récit de l’Exode) pour en arriver à une conclusion favorable
à ces derniers. Certains considèrent cette pratique comme légitime ;
d’autres crient à la faute. Nous voilà devant un problème plus vaste, un
sujet de débat doctrinal intense : peut-on se fier à la Bible pour quoi
que ce soit comme source historique ? Doit-on la considérer comme
« innocente » (c’est-à-dire historiquement exacte) jusqu’à ce que sa
« culpabilité » (c.-à-d., sa fausseté) soit prouvée ou comme « coupable »
à moins que et jusqu’à ce que ses affirmations puissent être corroborées
par des sources extérieures ?
C’est ce problème, qui est au cœur de notre sujet, que nous devons
maintenant aborder.
II. L’Exode et la guerre des cultures
Beaucoup de choses militent contre la Bible comme source historique
crédible. Elle contient des sujets tels que l’histoire du jardin d’Éden,
qui semblent franchement mythiques de nature. Elle raconte des événements
surnaturels qu’un historien moderne n’acceptera pas comme étant des faits
et elle décrit régulièrement des actions terrestres comme causées par
Dieu. Les spécialistes croient que beaucoup de ses textes ont été composés
des siècles après les événements prétendument documentés et — comme pour
l’Exode — peu de ces événements peuvent être corroborés par des sources
extérieures indépendantes.
En bref, la Bible, selon ce point de vue, est un livre de propagande
religieuse: de « l’histoire » qui répond à l’objectif de ses auteurs. Et
cette vision des choses a des bases solides. Mais ce n’en est pas moins
problématique pour autant et la raison en est simple : on peut faire le
même reproche à beaucoup d’autres inscriptions historiques du
Proche-Orient antique — et d’ailleurs. On trouve partout des textes
cunéiformes et hiéroglyphiques qui racontent des révélations divines à des
personnages royaux : une propagande manifeste en faveur des rois
d’autrefois et des dieux qu’ils servaient. Et la plupart des événements
rapportés dans ces documents anciens ne peuvent pas non plus être
corroborés par des renvois aux sources d’autres cultures. Fréquemment, les
événements eux-mêmes sont miraculeux : un pharaon défait à lui seul les
légions ennemies, par exemple, ou le serpent sculpté dans le diadème du
pharaon crache un feu dévorant ; les chiffres militaires sont
incroyablement grands. Souvent, les événements se sont produits, s’ils se
sont produits, des siècles avant la date de rédaction du texte.
Pourtant, à un degré ou à un autre, les savants acceptent régulièrement
ces textes comme historiquement fiables. Les chercheurs d’aujourd’hui
utilisent les œuvres de Tite-Live pour reconstituer l’histoire de la
République romaine, fondée plusieurs siècles avant sa naissance et tous
les historiens d’Alexandre le Grand reconnaissent comme leur source la
plus précise l’Anabase
d’Arrien, qui date de quatre siècles plus tard. Ils en excluent
bien entendu les éléments manifestement irréalistes, qu’ils détachent du
reste avant de créditer sa fiabilité. En revanche, quand il s’agit de
sources bibliques, les éléments douteux sont souvent considérés de prime
abord comme preuve du manque de fiabilité de l’ensemble.
Les savants acceptent régulièrement des textes contenant des événements
surnaturels comme historiquement fiables. Sauf dans le cas de la Bible,
naturellement.
C’est d’autant plus remarquable (pour ne pas dire plus) quand on sait
qu’il y a une différence importante entre la littérature biblique et les
écrits d’autres civilisations du Proche-Orient antique. D’un bout à
l’autre, la Bible a une nette tendance à juger durement ses héros et à
rapporter encore davantage les échecs d’Israël que ses succès. Aucune
autre culture du Proche-Orient antique n’a produit une littérature aussi
révélatrice des fautes, aussi réaliste concernant les abus de pouvoir ou
aussi scrupuleuse à mettre ces abus par écrit pour la postérité.
Là-dessus, au moins, tout le monde est d’accord. Et pourtant, dans les
milieux scientifiques, la prise en compte de ce fait n’a en rien amélioré
la réputation de la Bible comme rapporteuse honnête d’événements
historiques.
Faisons une expérience : Imaginons que
la Bible n’ait jamais parlé d’un asservissement d’Hébreux ou d’un exode
hors d’Égypte. Au lieu de cela, une histoire qui y ressemble beaucoup
apparaît dans une inscription datant du premier millénaire avant notre ère
au cours de fouilles effectuées en Transjordanie, le pays des Moabites
antiques. Racontant la période la plus reculée de ce peuple et de sa
divinité Kemosch, l’inscription rapporte que les Moabites étaient esclaves
en Égypte mais que le puissant Kemosch battit Amon et Rê à la mer,
libérant les esclaves et leur permettant de retourner chez eux à Moab,
tandis que leurs ennemis périssaient sous une tempête de grêle.
Face à un tel récit, les savants seraient assurément sceptiques devant les
éléments théologiques et surnaturels, mais je soupçonne qu’ils
chercheraient les indices d’un fond authentique, surtout s’il y avait des
indices périphériques du genre que j’ai indiqué ci-dessus à propos du
récit biblique. Ils seraient, par exemple, frappés par le fait que
l’histoire connaît manifestement bien les noms égyptiens, qu’elle est au
courant de la façon dont le delta oriental était peuplé et de la bonne
façon de nommer le pharaon, qu’elle connaît l’existence des fortifications
royales à l’extérieur de l’Égypte et la géographie de la péninsule du
Sinaï, du Néguev et de la Transjordanie. Et surtout, ils tiendraient
compte de la confirmation contemporaine de l’existence des Moabites dans
les sources non moabites.
Une fresque de l’ancienne synagogue de Dura Europos en Syrie, montrant les
Juifs traversant la mer Rouge avec Pharaon à leurs trousses.
Wikimedia.
Ces savants hypothétiques se précipiteraient-ils aussi sur l’absence de
toute mention d’esclaves moabites dans les sources égyptiennes ? J’en
doute : le fait que tant de détails du récit concordent avec ce que nous
savons de la période en conduirait beaucoup à considérer la source comme
digne de confiance, surtout en l’absence de preuves solides en sens
contraire.
La fiabilité des sources anciennes — qu’elles soient extra-bibliques ou
bibliques — est une question épineuse. Où finit la réalité et où commence
le façonnage des événements pour produire un message ? Du point de vue
scientifique, la Bible doit être soumise aux critères d’analyse appliqués
aux autres textes antiques comparables. Le fait qu’on ne la traite pas
ainsi — qu’on a recours à deux poids deux mesures — nous apprend quelque
chose sur le domaine des études bibliques dans le monde académique et sur
l’académie elle-même.
Le système de deux poids deux mesures appliqué aux textes bibliques est un
aspect essentiel du rapport de forces qui existe au sein des études
bibliques, qui, en tant que discipline universitaire, constituent une
sorte d’anomalie. La Bible est aujourd’hui étudiée dans toutes sortes
d’institutions qui décernent des diplômes, depuis celles qui sont
entièrement laïques jusqu’à celles qui sont le plus dogmatiques. Mais
contrairement à Shakespeare ou aux discours de Cicéron ou à l’épopée de
Gilgamesh ou au Code d’Hammourabi, la Bible est une anomalie en
elle-même : elle est non seulement un ouvrage qu’on lit et étudie mais,
pour beaucoup, un ouvrage qui guide la vie elle-même, un ouvrage
d’écriture sacrée. […]
III. Plus pharaon que le pharaon
Pour résumer jusqu’ici : il n’y a aucun élément de preuve explicite qui
confirme l’Exode. Au mieux, nous avons un texte — la Bible hébraïque — qui
manifeste une bonne maîtrise d’un large éventail d’aspects assez standard
des réalités égyptiennes antiques. C’est certainement quelque chose et il
ne faut pas le négliger ; mais y a-t-il quelque chose d’autre à dire ?
[J’ai fait une découverte] qui révèle un lien explicite entre le récit
biblique et un texte bien précis d’un règne bien déterminé dans l’histoire
égyptienne. [Voici de quoi il s’agit :]
L’un des piliers de l’étude critique moderne de la Bible est ce qu’on
appelle la méthode comparative. Les savants déblaient un texte biblique en
relevant les ressemblances entre lui et les textes trouvés parmi les
cultures voisines de l’ancien Israël. Si les ressemblances sont nombreuses
et véritablement propres aux deux types de sources, il devient plausible
d’affirmer que le texte biblique peut avoir été écrit sous l’influence
directe du texte extrabiblique ou en réponse à ce texte. Pourquoi le sens
unique de l’extrabiblique au biblique ? La réponse est qu’Israël a été en
grande partie un joueur faible entouré politiquement mais aussi
culturellement par des forces beaucoup plus importantes et qu’on n’a
jamais trouvé aucun texte hébreu de l’époque antérieure à l’exil à
Babylone (586 avant notre ère) qui ait été traduit dans d’autres langues.
Par conséquent, on considère habituellement que les ressemblances entre la
Bible et les textes en akkadien ou en égyptien sont le reflet de
l’influence de ceux-ci sur elle.
Bien que la méthode comparative soit communément perçue comme une approche
moderne, son premier praticien n’était autre que Moïse Maïmonide au XIIe
siècle. Afin de comprendre correctement l’écriture, dit Maïmonide, il
s’était procuré tous les travaux sur les civilisations anciennes connus à
son époque. Dans son Guide des égarés, il utilise la connaissance
qui en a découlé pour dégager le raisonnement qui était à la base des lois
et des pratiques du culte dans la Torah, se disant qu’elles étaient des
adaptations d’anciennes coutumes païennes, mais déformées pour les rendre
conformes à une théologie antipaïenne. […] À la fin du Guide,
Maïmonide dit que sa compréhension de la question aurait été bien plus
grande s’il avait pu découvrir encore plus de sources de ce genre.
La méthode comparative peut produire des résultats éblouissants, ajoutant
des dimensions à la compréhension de passages qui semblaient auparavant
soit peu clairs, soit allant de soi et n’ayant rien d’exceptionnel. Par
exemple, pensez au refrain biblique bien connu que Dieu a sorti Israël
d’Égypte « à main forte et à bras étendu ». La Bible aurait pu employer
cette expression pour décrire une multitude d’actes divins en faveur
d’Israël et pourtant l’expression est utilisée uniquement en
référence à l’Exode. Ce n’est pas un hasard. Dans une grande partie de la
littérature royale égyptienne, l’expression « main forte [ou main
puissante] » est un synonyme du pharaon et il y est dit de bon nombre
d’actions du pharaon qu’elles sont effectuées par sa « main forte « ou son
« bras étendu ». Nulle part ailleurs dans le Proche-Orient antique les
souverains ne sont décrits de cette façon. Qui plus est, c’est dans la
propagande royale égyptienne de la dernière partie du deuxième millénaire
que l’on trouve le plus souvent cette expression.
Pourquoi le livre de l’Exode décrirait-il Dieu dans les mêmes termes que
ceux utilisés par les Égyptiens pour glorifier leur pharaon ? Nous voyons
ici jouer la dynamique de l’appropriation. Pendant une grande partie de
son histoire, l’Israël antique a été dans l’ombre de l’Égypte. Pour les
peuples faibles et opprimés, une forme de résistance culturelle et
spirituelle est de s’approprier les symboles de l’oppresseur et de les
utiliser à des fins de concurrence idéologique. Je crois, et j’ai
l’intention de le montrer dans ce qui suit, que dans son récit de l’exode,
la Bible s’approprie bien plus que de simples symboles et expressions —
que, en bref, elle adopte et adapte l’un des récits les plus connus de
l’un des plus grands de tous les pharaons égyptiens.
Un petit contexte s’impose ici. Comme tous les grands empires antiques,
l’Égypte ancienne a eu son ascension et son déclin. Elle parvint à
l’apogée de sa gloire sous le Nouvel Empire, vers 1500-1200 avant notre
ère. C’est alors que ses frontières atteignirent leurs limites les plus
éloignées et que beaucoup des monuments massifs encore visibles
aujourd’hui furent construits. Nous avons déjà rencontré le plus grand
pharaon de cette période, Ramsès II, également connu à juste titre comme
Ramsès le Grand, qui régna de 1279 à 1213.
L’exploit suprême de Ramsès, qui eut lieu au début de son règne, fut sa
victoire de 1274 sur l’ennemi juré de l’Égypte, l’empire hittite, à la
bataille de Qadesh, une ville située sur l’Oronte à la frontière moderne
entre le Liban et la Syrie. À son retour en Égypte, Ramsès inscrivit le
récit de cette bataille sur des monuments partout dans l’empire. Il en
existe encore dix exemplaires à ce jour. Ces copies multiples font de la
bataille de Qadesh l’événement le plus médiatisé de tout le monde antique,
plus même que ceux de la Grèce et de Rome. En outre, les textes étaient
accompagnés d’une nouvelle création : des bas-reliefs représentant la
bataille, image par image, afin que — tout comme pour les vitraux dans les
églises médiévales — les spectateurs qui ne connaissaient pas les
hiéroglyphes puissent apprendre les exploits du pharaon.
Ceci nous amène à ce qui est depuis longtemps une énigme biblique. Les
savaient avaient longtemps cherché un modèle, un précurseur, qui pourrait
avoir inspiré le plan du Tabernacle qui servit de centre de culte pour le
campement des Israélites dans le désert, un plan décrit dans les moindres
détails dans Exode 25-29. Bien que les vestiges des temples phéniciens
révèlent un plan remarquablement ressemblant à celui du temple de Salomon
(construit, faut-il le préciser, avec l’aide considérable d’un roi
phénicien), aucun site cultuel connu dans le Proche-Orient antique ne
semblait ressembler au Tabernacle du désert. Et puis, il y a quelque 80
ans, on remarqua une affinité inattendue entre les descriptions bibliques
du Tabernacle et les illustrations du camp de Ramsès à Qadesh dans
plusieurs bas-reliefs.
Dans l’image ci-dessous de la bataille de Qadesh, le camp militaire
fortifié occupe le grand espace rectangulaire dans la moitié inférieure du
bas-relief :
La tente du trône de Ramsès II avec les faucons ailés flanquant son
cartouche à Abou Simbel
.
W. Wreszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte Vol. II
(1935), pl. 169.
Le camp est deux fois aussi long que large. L’entrée se trouve au milieu
du mur oriental à gauche. (Dans les illustrations égyptiennes, l’est est à
gauche, l’ouest est à droite.) Au centre du camp, au bout d’un long
couloir, se trouve l’entrée d’une tente rectangulaire de 3 sur 1. Cette
tente contient deux sections : une tente de réception de 2 sur 1, avec des
personnages agenouillés en signe d’adoration et, menant vers l’ouest (à sa
droite), un espace carré bombé qui est la tente du trône du pharaon.
Toutes ces proportions se retrouvent dans les prescriptions pour le
Tabernacle et le camp qui l’entoure dans Exode 25-27, comme les deux
schémas ci-dessous le montrent :
Dans la tente du trône, mise en plus gros plan ci-dessous, l’emblème
portant le nom du pharaon et symbolisant son pouvoir est flanqué de
faucons qui symbolisent le dieu Horus, avec leurs ailes ouvertes pour le
protéger :
Dans l’Exode (25:20), l’arche du Tabernacle est de même flanquée de deux
chérubins ailés, dont les ailes sont ouvertes pour le protéger. Pour
compléter le parallèle, les quatre divisions de l’armée égyptienne à
Qadesh auraient campé sur les quatre côtés de l’enceinte militaire de
Ramsès ; le livre des Nombres (2) dit que les tribus d’Israël campaient
sur les quatre côtés de l’enceinte du Tabernacle.
La ressemblance du camp militaire de Qadesh avec le Tabernacle va plus
loin que l’architecture ; elle est également conceptuelle. Pour les
Égyptiens, Ramsès était à la fois un chef militaire et une divinité. Dans
la Torah, Dieu est également une divinité, évidemment, mais aussi le chef
d’Israël au combat (voir Nombres 10:35-36). La tente de Dieu, guerrier
divin, est semblable à la tente du pharaon, le dieu égyptien vivant, prête
pour la bataille.
Qu’est-ce que les savants ont retiré de cette observation ? Tous
conviennent qu’aucune image visuelle que nous connaissions des annales
antiques ne ressemble autant au Tabernacle que la tente du trône de
Ramsès. Il n’y a non plus aucune description dans les textes d’une tente
cultuelle ou d’une tente du trône dans un camp militaire qui corresponde à
ces dimensions. Sur cette base, certains savants ont effectivement dit que
les bas-reliefs des inscriptions de Qadesh ont inspiré la conception du
Tabernacle dans Exode 25-27. Dans leur esprit, les Israélites ont
retravaillé idéologiquement la tente du trône, avec Dieu remplaçant Ramsès
le Grand comme la force la plus puissante de l’époque. (Bien entendu, pour
la Torah, Dieu ne peut pas être représenté dans une image et ne nécessite
aucune protection, et les divinités païennes n’ont pas de pouvoir, ce qui
explique pourquoi, au lieu de faucons et d’Horus, nous avons des chérubins
recouvrant de leurs ailes protectrices l’arche portant les tables de son
alliance avec Israël.) D’autres croient que l’image de la tente du trône
s’est, dans un premier temps, fondue dans la culture israélite d’une
manière que nous ne pouvons pas reconstituer et a été intégrée plus tard
dans le texte décrit dans l’Exode, mais sans souvenir conscient de Ramsès
II. D’autres encore restent sceptiques, considérant que les ressemblances
ne sont qu’une coïncidence.
J’ai eu une réaction différente.
Une fois mon
intérêt éveillé par les ressemblances visuelles entre le Tabernacle
et la tente du trône de Ramsès, j’ai décidé de regarder de plus près les
composantes textuelles des inscriptions de Qadesh pour apprendre ce
qu’elles avaient à dire au sujet de Ramsès, des Égyptiens et de la
bataille de Qadesh. Dans un premier temps, quelques points à gauche et à
droite — comme la référence au bras puissant du pharaon, mentionnée plus
haut — m’ont sauté aux yeux comme étant en résonance avec les termes du
récit de l’Exode. Mais en lisant et en relisant, je me suis rendu compte
qu’il y avait là bien plus qu’une affaire de quelques expressions ou
images — que les ressemblances s’étendaient à l’ensemble de l’intrigue du
poème de Qadesh et à celle de la séparation de la mer dans Exode 14-15.
Plus j’examinais d’autres récits de batailles du Proche-Orient antique,
plus cette ressemblance me frappait, à tel point que je pense qu’il est
raisonnable d’affirmer que le récit de la séparation de la mer (Exode 14)
et le Cantique de Moïse et des Israélites (Exode 15) peuvent constituer un
acte délibéré d’appropriation culturelle. Si les inscriptions de Qadesh
témoignent du plus grand exploit du plus grand pharaon de la plus grande
période de l’histoire égyptienne, le livre de l’Exode, quant à lui,
affirme que le Dieu d’Israël a fait infiniment mieux que Ramsès le Grand,
le battant à plate couture à son propre jeu.
Voyons comment cela fonctionne. Dans le poème de Qadesh et le récit de
l’Exode 14-15, l’action commence de la même façon : l’armée des
protagonistes (respectivement celle des Égyptiens et celle des Israélites)
est en marche et n’est pas préparée pour la bataille lorsqu’elle est
attaquée par une force importante de chars, la faisant rompre les rangs
sous l’effet de la peur. Ainsi, d’après le poème de Qadesh, les
troupes de Ramsès sont en train de
faire mouvement vers le nord vers la périphérie de Qadesh lorsqu’elles
sont surprises par un corps de chars hittites et prennent peur. Le récit
de l’Exode s’ouvre de la même façon. À leur sortie d’Égypte, les
Israélites sont décrits comme étant une force armée (Exode 13:18 et 14:8).
Mais abasourdis par la charge soudaine des chars du pharaon, ils
deviennent complètement découragés (14:10-12).
Dans chaque histoire, le protagoniste appelle son dieu à l’aide et le dieu
l’exhorte à aller de l’avant avec l’aide divine. Dans le poème de Qadesh,
Ramsès prie Amon, qui répond : « En avant ! Je suis avec toi, je suis ton
père, ma main est avec toi! » […] De même, Moïse crie à l’Éternel, qui
répond dans 14:15, « Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils
marchent! », promettant la victoire sur le pharaon (v. 16-17).
À partir de ce moment, dans le poème de Qadesh, Ramsès acquiert des
proportions et des pouvoirs divins. Autrement dit, il se transforme du
dirigeant humain en détresse qu’il était en une force quasi divine, ce qui
nous permet d’examiner ses actions contre les Hittites au ord de l’Oronte
parallèlement aux actions de Dieu contre les Égyptiens au bord de la mer.
Dans chaque récit, le « roi » affronte l’ennemi tout seul, sans l’aide
de ses troupes apeurées. Entièrement abandonné par son armée, Ramsès se
jette tout seul sur les Hittites, un thème souligné tout au long du poème.
Dans Exode 14:14, Dieu déclare qu’Israël doit simplement rester passif et
qu’il se battra pour lui : « L’Éternel combattra pour vous ; et vous,
gardez le silence. » Il vaut la peine ici de noter que cette particularité
des deux ouvrages — leur portrait parallèle d’un « roi » victorieux qui
doit travailler dur pour assurer la fidélité de ceux qu’il sauve au combat
— n’a pas son pareil dans la littérature du Proche-Orient antique.
Dans chacun de ces textes, l’ennemi dit ensuite l’inutilité de vouloir
lutter contre une force divine et cherche à s’échapper. Dans chacun, ce
qui a été dit précédemment sur la puissance du personnage divin est
maintenant confirmé par l’ennemi lui-même. Dans le poème de Qadesh, les
Hittites se retirent devant Ramsès: « L’un d’eux cria à son camarade :
Prépare-toi, garde-toi, ne l’approche pas ! Regarde ! Sekhmet la grande
est celle qui est avec lui! », parlant d’une déesse vantée précédemment
dans le poème. Dans ce passage, les Hittites reconnaissent qu’ils
combattent non seulement une force divine, mais une force divine très
particulière. Nous trouvons le même trope dans le récit de l’Exode :
confondus par Dieu dans 14:25, les Égyptiens disent : « Fuyons devant
Israël, car l’Éternel
combat pour lui contre les Égyptiens. »
Un élément commun à ces deux textes est la submersion de l’ennemi dans
l’eau. Le poème de Qadesh ne donne pas à cet événement un rôle aussi
central que l’Exode — il ne parle pas de mer balayée par le vent écrasant
les Hittites — mais Ramsès proclame effectivement avec vantardise que dans
leur hâte pour échapper à son assaut, les Hittites vont chercher refuge en
« plongée » dans le fleuve, sur quoi il les massacre dans l’eau. Les
reliefs représentent la noyade des Hittites d’une façon percutante, que
l’on voit ici en panorama et en gros plan :
Les cadavres des troupes hittites dans le fleuve Oronte, comme représenté
sur le deuxième pylône au Ramesséum.
James Henry Breasted, La
bataille de Qadesh : une étude de la stratégie militaire la plus ancienne
connue (Chicago University Press, 1903), pl.
III.
Pour ce qui est des survivants, les deux récits affirment qu’il n’y en a
aucun. Le poème de Qadesh dit: « Nul ne regardait en arrière, aucun autre
ne faisait demi-tour. Quiconque d’entre eux tombait ne se relevait plus.
« Exode 14:28: « Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les
cavaliers et toute l’armée […] et il n’en échappa pas un seul. »
Nous arrivons maintenant au plus frappant des parallèles entre les deux.
Dans chacun, les troupes timides voient les preuves du « bras puissant »
du roi, passent en revue les cadavres ennemis et, stupéfaits de l’exploit
du souverain, se sentent poussés à chanter un cantique de louange. Dans le
poème de Qadesh, nous lisons :
« Puis, quand mon infanterie et ma charrerie
virent que j’étais comme
Montou, que mon bras était puissant
[…] alors ils se mirent à revenir au camp pour passer la nuit, au temps du
soir, et ils trouvèrent tous les pays étrangers dans lesquels j’avais
pénétré gisant dans leur sang […] J’avais rendu blanc [avec leurs
cadavres] la campagne du pays de Qadesh. Alors mon armée se mit à me
louer, le visage surpris de ce que j’avais fait. »
Exode 14:30-31 est remarquablement similaire et dans deux cas identique:
« Israël vit sur le rivage de
la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit
la main puissante que l’Éternel
avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit
l’Éternel. » Comme je l’ai déjà mentionné, la « main puissante » ici et la
« grandeur du bras » dans 15:16 sont utilisées exclusivement dans la Bible
hébraïque en ce qui concerne l’Exode, un trope qu’on ne trouve ailleurs
que dans la propagande égyptienne, surtout au cours du Nouvel Empire à la
fin du deuxième millénaire.
Après la grande conquête, dans les deux récits, les troupes offrent un
hymne au roi. Dans chacun, le premier vers est constitué de trois
éléments. Les troupes louent le nom du roi en tant que guerrier, lui
attribuent le mérite de leur avoir remonté le moral et le portent aux nues
pour avoir assuré leur salut. Dans le poème de Qadesh, nous lisons :
« Mes officiers supérieurs se mettent à magnifier mon bras puissant, et ma
charrerie fière de ma réputation et déclarant : ‘Quel excellent guerrier
qui ranime le cœur ! Tu as sauvé ton infanterie et ta charrerie !’ »
Et voici les mêmes motifs dans les premiers versets du Cantique de Moïse
et des Israélites (Exode 15:1-3) :
« Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Éternel
[…] ‘L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est lui qui
m’a sauvé [...] L’Éternel est un vaillant guerrier ; l’Éternel est son
nom.’ »
Tant dans le poème que dans l’Exode, l’éloge du souverain victorieux
continue dans une strophe double vantant sa main ou son bras puissants. Le
poème: « Tu es le fils d’Amon, réalisant avec ses bras, tu dévastes le
pays de Hatti par ton bras vaillant. » Le Cantique (Exode 15:6): «Ta
droite, ô Éternel ! a signalé sa force ; Ta droite, ô Éternel ! a écrasé
l’ennemi. »
Et notez ceci : la racine hébraïque qui désigne la main droite (ymn)
est commune à diverses autres langues du Proche-Orient antique. Et
pourtant, dans ces autres cultures, la main droite est liée exclusivement
à la notion de tenir ou de saisir. Par contre, dans la littérature
égyptienne, nous trouvons des descriptions de la main droite qui
correspondent à celle du Cantique. Le motif sans doute le plus omniprésent
dans l’art narratif égyptien est le pharaon levant la main droite pour
faire éclater la tête des ennemis captifs :
Bas-relief de Seti I (XIIIe siècle avant notre ère) la main
droite levée, brisant la tête de ses ennemis, Salle hypostyle de Karnak.
The Epigraphic Survey, The Battle Reliefs of King Seti I (Chicago,
1986), pl. 15a.
Avec la permission de l’Institut Oriental de l’Université de Chicago.
Cette image royale égyptienne a continué d’exister depuis le troisième
millénaire jusqu’à l’ère chrétienne. Il n’existe aucune autre civilisation
proche-orientale où nous rencontrons ces descriptions de la main droite,
qui évoquent irrésistiblement le Cantique et en particulier 15:6: «Ta
droite, ô Éternel ! a écrasé l’ennemi. »
Pour continuer maintenant : dans le poème de Qadesh, quand les troupes
contemplent les cadavres hittites, leurs ennemis sont comparés à du
chaume : « Amon mon père étant avec moi instantanément, transformant tous
les pays étrangers en chaume devant moi. » De même, le Cantique compare
l’ennemi à du chaume consumé par la colère de Dieu (15:7): « Tu déchaînes
ta colère : Elle les consume comme du chaume. » Encore une fois, aucune
autre inscription militaire du Proche-Orient antique n’utilise le
« chaume » comme comparaison pour désigner l’ennemi.
Autres parallèles : dans chaque cantique, les troupes déclarent que leur
roi est sans égal dans la bataille. Le poème de Qadesh: « Tu es le
meilleur guerrier, sans ton égal » ; le Cantique : « Qui est comme toi
parmi les dieux, ô Éternel ? » Dans chacun, le roi est salué comme le chef
victorieux de ses troupes, intimidant les pays voisins. Le poème de
Qadesh: « Tu es grand de victoires en présence de ton armée [...]
protégeant l’Égypte, et courbant les pays étrangers »; le Cantique
(15:13-15) : « Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple ;
par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples
l’apprennent, et ils tremblent. »
Vers la fin, les deux partagent à nouveau les éléments principaux quand le
roi ramène ses troupes en toute sécurité sur un long voyage de retour
après la victoire sur l’ennemi, en intimidant les pays voisins en cours de
route. Le poème de Qadesh : « Ma Majesté s’en retourna en paix vers
l’Égypte avec son infanterie et sa charrerie, toute vie, stabilité et
domination étant avec elle […] soumettant tous les pays par crainte de
lui. » Le Cantique (15:16-17) : « La crainte et la frayeur les
surprendront ; par la grandeur de ton bras ils deviendront muets comme une
pierre, jusqu’à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel ! Jusqu’à ce qu’il
soit passé, le peuple que tu as acquis. » Et le motif final leur est
également commun : l’arrivée pacifique au palais du roi et les
bénédictions sur son règne éternel. Le poème de Qadesh :
« Ayant atteint l’Égypte en paix à
Pi-Ramsès-aimé-d’Amon-grand-de-victoire, et demeurant dans son palais de
vie et de domination […] les
dieux de son pays vinrent à lui, l’honorant [...] Ils le gratifièrent de
millions de fêtes-Sed, pour toujours sur le trône de Rê, toutes les terres
et tous les pays étrangers étant prosternés pour l’éternité, sans fin. »
Le Cantique (15:17-18) :
« Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, Au
lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel ! Au sanctuaire,
Seigneur ! que tes mains ont fondé. L’Éternel régnera éternellement et à
toujours. »
Le lecteur l’aura compris :
le poème de Qadesh est une composition beaucoup plus longue que le récit
de l’Exode, et il contient de nombreux éléments sans parallèles dans ce
dernier. Par exemple, Ramsès fait une longue prière à son dieu, Amon, et
lance deux longs reproches à ses troupes pour leur déloyauté envers lui.
Mais l’appropriation d’un texte à des fins de résistance culturelle ou de
rivalité est toujours sélective et n’est jamais un exercice point par
point. Le texte de l’Exode se concentre précisément sur les éléments du
poème de Qadesh qui exaltent la bravoure du pharaon, qu’il retravaille
afin d’exalter celle de Dieu. En outre, les principaux éléments de
l’intrigue — il est important de le souligner à nouveau — sont communs aux
deux. Les voici :
L’armée protagoniste rompt les rangs à la vue des chars ennemis ; il y a
un appel à l’aide divine auquel il est répondu par un encouragement à
aller de l’avant, la victoire assurée ; la charrerie ennemie,
reconnaissant par son nom la force divine qui s’attaque à elle, cherche à
fuir ; beaucoup trouvent la mort dans l’eau et il n’y a aucun survivant ;
les troupes du roi reviennent pour contempler les cadavres ennemis ;
stupéfaites de l’exploit du roi, elles offrent un hymne de victoire qui
inclut des louanges à son nom, des références à son bras puissant, un
hommage rendu à lui comme source de leur force et de leur salut ; l’ennemi
est comparé à du chaume, tandis que le roi est réputé sans égal au
combat ; le roi ramène ses troupes en paix à la maison en intimidant les
pays étrangers en cours de route ; le roi arrive à son palais et un règne
éternel lui est accordé.
Telle est l’histoire de Ramsès II dans le poème de Qadesh, telle est
l’histoire de Dieu dans le récit de la mer dans Exode 14-15.
À quel point ces parallèles sont-ils distinctifs ? Je suis pleinement
conscient de ce que les ressemblances entre deux textes antiques
n’impliquent pas automatiquement que l’un a été inspiré par l’autre
et aussi que des termes et des images courants étaient également la
propriété intellectuelle de plusieurs cultures en même temps. Certains des
motifs identifiés ici, notamment la terreur et la crainte respectueuse de
l’ennemi devant le roi, sont omniprésents dans l’ensemble des récits de
batailles dans le Proche-Orient antique. D’autres éléments, tels que le
roi construisant son palais ou y résidant et acquérant un règne éternel,
sont des tropes typologiques que nous connaissons dans d’autres ouvrages
antiques. D’autres encore, bien que propres à ces deux ouvrages, peuvent
sans doute être considérés comme reflétant une situation semblable, ou des
besoins de l’auteur, sans qu’il y ait nécessairement des liens entre eux.
Ainsi, bien que peu ou pas de récits antiques de batailles parlent d’une
armée en marche qui est soudainement attaquée par une force massive de
chars et rompt les rangs à cause de cela, il se pourrait quand même que
l’Exode et le poème de Qadesh emploient ce motif indépendamment.
Ce qui suggère vraiment une relation entre les deux textes, c’est la
totalité des parallèles, à quoi vient s’ajouter le grand nombre de
motifs très distinctifs qui apparaissent uniquement dans ces deux
ouvrages. Aucun autre récit de bataille qui nous soit parvenu, que ce soit
dans la Bible hébraïque ou dans des vestiges épigraphiques du
Proche-Orient antique, ne nous donne ne serait-ce que la moitié des motifs
narratifs communs exposés ici.
Pour approfondir la connexion, j’ajouterai une autre résonance encore
entre le Cantique et des inscriptions plus générales du Nouvel Empire
égyptien. Un motif littéraire courant de la période est l’affirmation que
le pharaon fait en sorte que les troupes ennemies cessent leurs
fanfaronnades. Ainsi, dans un passage typique, le pharaon Seti Ier
« fait que les princes de Syrie cessent toute la vantardise de leur
bouche ». Cette préoccupation de vouloir réduire au silence les
vantardises de l’ennemi est typiquement égyptienne ; on ne la retrouve
dans la littérature militaire d’aucune autre culture voisine. Il n’en est
donc que plus remarquable que le Cantique ne dépeint pas les mouvements ou
les actions des Égyptiens, mais leur vantardise (15:9): « L’ennemi
disait : Je poursuivrai, j’atteindrai, Je partagerai le butin ; Ma
vengeance sera assouvie, Je tirerai l’épée, ma main les
détruira. » Là-dessus, sur un commandement de Dieu, la mer les recouvre,
ce qui les fait effectivement taire.
Ainsi donc, à mon avis, les ressemblances entre ces deux textes sont
tellement frappantes et si propres à eux seuls, qu’on peut parfaitement
affirmer qu’il y a interdépendance littéraire. Ce qui nous amène à la
question : si, pour les besoins de ma démonstration, nous partons du
postulat que le récit de la mer dans l’Exode a été composé par quelqu’un
qui connaissait l’existence du poème de Qadesh, quand ce poème aurait-il
pu être introduit dans la culture israélite ? La question est importante
en soi et aussi parce que la réponse pourrait aider, à son tour, à
déterminer la date du texte de l’Exode.
Une possibilité pourrait être que le poème a atteint Israël à une période
de relations amicales avec l’Égypte, peut-être sous le règne de Salomon au
Xe siècle, ou, plus tard encore, d’Ézéchias au VIIIe.
Toutefois, il y a quelque chose qui milite contre ceci, c’est que les
copies les plus tardives du poème de Qadesh que nous ayons sont du XIIIe
siècle et il n’en est plus fait explicitement mention, ni aucune tentative
claire de l’imiter dans la littérature égyptienne postérieure. En outre,
nous n’avons aucune preuve épigraphique qu’une inscription historique
quelconque de l’ancienne Égypte
soit jamais parvenue jusqu’en Israël ou dans le royaume de Juda, que ce
soit en langue égyptienne ou en traduction. Et je ne parle même pas, pour
commencer, du problème de savoir ce qui, dans une période d’entente,
aurait motivé un scribe israélite à écrire un ouvrage explicitement
anti-égyptien.
Pour déterminer une date de transmission plausible, nous devons nous
laisser guider par les éléments épigraphiques dont nous disposons. Les
égyptologues notent qu’en plus des copies de la version monumentale du
poème de Qadesh, une copie sur papyrus a été trouvée dans un village
d’ouvriers et d’artisans qui ont construit les grands monuments de Thèbes.
On l’a vu précédemment, des récits visuels de la bataille ont également
été créés. Cela a amené plusieurs spécialistes de l’Égypte antique à
affirmer que le poème de Qadesh a été un « petit livre rouge » largement
diffusé visant à provoquer l’adoration publique de la bravoure et de la
grâce salvifique de Ramsès le Grand, et qu’il devait être connu d’un grand
nombre de personnes, en particulier sous le règne de Ramsès lui-même,
au-delà des murs du palais et du temple.
Que faut-il conclure de tout cela ? Qu’est-ce que cela prouve ?
Les preuves existent en géométrie et parfois en droit, mais rarement dans
les domaines de l’archéologie et des études bibliques. Comme c’est si
souvent le cas, la documentation qui est à notre disposition est très
incomplète et les suppositions sur la transmission culturelle doivent
rester au second plan. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec le peu
que nous avons en invoquant davantage la plausibilité que la preuve. Pour
être clair à ce sujet, les parallèles que j’ai établis ici ne « prouvent »
pas l’exactitude historique du récit de l’Exode, certainement pas dans son
intégralité. Ils ne prouvent pas que le texte que nous avons a reçu sa
forme définitive au XIIIe siècle avant notre ère. Et ils
peuvent et pourront sans aucun doute être interprétés de différentes
manières par des êtres rationnels, aussi bien laïques que professionnels,.
Certains pourraient conclure que le contenu du poème de Qadesh est parvenu
en Israël dans des conditions qui nous sont cachées et, pour des raisons
que nous ne pouvons pas connaître, s’est intégré au texte de l’Exode
plusieurs siècles en aval. D’autres considéreront les parallèles comme une
grande coïncidence. Mais ma conclusion à moi est autre : les éléments de
preuve qui ont été présentés ici peuvent être raisonnablement considérés
comme indiquant que le poème a été transmis au cours de la période de sa
plus grande diffusion, qui est la seule période où les gens
en Égypte semblent y avoir accordé
beaucoup d’attention : à savoir, sous le règne de Ramsès II lui-même. À
mon avis, l’évidence indique que le texte de l’Exode conserve le souvenir
d’un moment où les tout premiers Israélites ont recherché des termes
permettant de vanter les grandes vertus de Dieu et trouvé la matière
première dans les termes et les tropes d’un texte égyptien bien connu
d’eux. En s’appropriant et en « transvaluant » ce texte, ils avancent
l’affirmation que le Dieu d’Israël avait surpassé de loin le plus grand
exploit du plus grand des potentats terrestres.
Lorsqu’ils se rassemblent le soir de la Pâque pour fêter l’Exode et la
libération de l’oppression égyptienne, les Juifs du monde entier peuvent
exprimer les mots de la Haggadah : « Nous étions esclaves d’un pharaon en
Égypte « avec confiance et intégrité, sans avoir recours à un énorme acte
de foi et sans avoir besoin d’interpréter ces mots comme étant une simple
métaphore. Ils sont épaulés par une interprétation plausible des faits.
|