 |
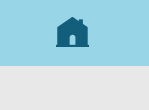 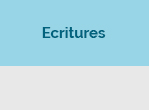   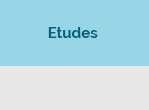  |
|
Le Discours du roi Benjamin – Contexte, complexité et fécondité
Kevin Christensen
Pendant que je faisais une mission en Angleterre en 1973-1975, un de mes
contacts a fait une réflexion au sujet du discours du roi Benjamin. Il m’a
montré le chapitre 4, verset 2, qui décrit la multitude s’écriant « d'une
seule voix, disant: Oh! sois miséricordieux, et applique le sang
expiatoire du Christ
». Le fait que le texte disait que tout le monde était tombé par terre et
que tout le monde avait fait alliance lui posait un problème.
« Les gens ne réagissent pas d’une manière aussi unanime, m’a-t-il dit.
Tout le monde n’aurait pas été d’accord. Certains auraient refusé. »
À l'époque, le mieux que je pouvais faire était de dire : « C'était un bon
discours. » Comme on pouvait s’y attendre, cela ne l'a pas impressionné.
J'ai mis sa question au frigo, et environ un an plus tard, un membre de la
branche de Lancaster m’a prêté un exemplaire du manuel de la prêtrise pour
1957 de Hugh Nibley, An Approach to
the Book of Mormon.
Le jour de préparation suivant, je l'ai emporté dans ma baignoire, en me
disant que pendant que je trempais, je pouvais lire les chapitres qui me
semblaient intéressants.
J'ai lu le livre entier avant de sortir de la baignoire et j’ai été
particulièrement frappé par le chapitre de Nibley sur le « Rituel du Vieux
Monde dans le Nouveau Monde ». Nibley y démontre que le discours du roi
Benjamin était un rite de couronnement basé sur un rituel constitué de
trente-six éléments. Le professeur Welch résume ces éléments comme suit :
« … Proclamation, transfert de royauté, assemblée autour du temple,
recensement, présentation des premiers-nés des troupeaux et des offrandes,
actions de grâces pour la délivrance, logement dans des tentes autour du
temple, discours du roi du haut d'une tour, appel ou silentium et
enseignement des mystères, salutation au roi, hommage du peuple au roi
(hommage que Benjamin rejette), purification, acclamation du roi,
narration du récit de la création, adieu rituel et descente du roi aux
enfers (que Benjamin qualifie d’événement littéral qui va bientôt se
produire), chorales, assurance de la succession au trône, promesses de
paix et de prospérité, préservation d’annales, préservation du peuple par
Dieu, promesses de bonheur sans fin, divination du futur, jour du
jugement, prosternation devant le roi, vision de tous les hommes comme
égaux, acclamation de clôture,
alliance, réception d'un nouveau nom, engendrement du genre humain,
nécessité de se tenir au bon
endroit, avoir un sceau, enregistrement de noms, nomination de prêtres
pour rappeler son alliance au peuple et congédiement1.
»
Notez que toutes les personnes qui assistent à la cérémonie sont censées à
la fois tomber par terre et faire une alliance. Les choses mêmes qui
dérangeaient mon ami de l’Église quand elles étaient vues sous l’angle de
son expérience personnelle moderne se transformaient en preuves en faveur
du Livre de Mormon lorsqu’on les voyait à la lumière du contexte antique.
En effet, lorsqu'il présente la leçon dans le manuel de la prêtrise,
Nibley écrit: « De l’avis de l’auteur, cette leçon présente la preuve la
plus convaincante jamais apportée de l'authenticité du Livre de Mormon. Il
est très probable que le lecteur sera loin de partager ce point de vue,
étant donné que la force de la preuve est cumulative et repose sur des
études comparatives considérables qui ne peuvent pas être entièrement
présentées ici)2.
»
La perception de Nibley m'a aidé à comprendre le sens de la parabole du
semeur. J'ai vu que la même histoire, les mêmes mots, pouvaient avoir des
rendements très différents selon le terrain dans lequel ils étaient semés
et le soin avec lequel ils étaient cultivés.
Dans ce cas-ci, le terrain était le contexte : le fait de le lire dans
l’esprit des idées reçues d’aujourd’hui ne pouvait qu’être beaucoup moins
parlant que le lire dans son
contexte antique. Comme le dit Néphi, nous ne pouvons pas comprendre les
écrits des anciens sans étudier leur culture (2 Néphi 25:5). Comme Jésus
le dit au peuple dans 3 Néphi, on ne peut pas tout comprendre d’emblée,
nous devons nous préparer l’esprit (3 Néphi 17:3).
Une fois que cette première lecture de Nibley a complètement transformé ma
façon de lire le discours du roi Benjamin, j'ai découvert que beaucoup
d’autres chercheurs ont démontré d’autres aspects impressionnants du même
discours :
Mention du nom du Seigneur
L’une des observations les plus frappantes des professeurs Welch et Szinc
porte sur les noms divins utilisés dans le texte. Le jour des expiations
était tellement saint que ce jour-là le nom ineffable de Dieu, YHWH,
pouvait être prononcé. Lors du service de Yom Kippour dans le temple, le
prêtre pouvait prononcer ce nom sacré à haute voix. La tradition juive
ultérieure semble avoir voulu que le prêtre prononce dix fois ce nom au
cours de la liturgie du Yom Kippour et, dans une même mesure, Benjamin
emploie les noms étendus Seigneur Dieu et Seigneur Omnipotent
sept et trois fois respectivement.
La réaction du peuple lorsque le nom sacré est prononcé est curieuse.
Selon la Mishna, chaque fois que le peuple au temple de Jérusalem
entendait le nom sacré, il se prosternait par terre.
On peut comparer cela avec les réactions au discours du roi Benjamin à
Zarahemla. Quand il eut fini de réciter les paroles de l'ange, «il
jeta les regards autour de lui sur la multitude, et voici, elle était
tombée par terre, car la crainte du Seigneur était venue sur elle
» (Mosiah 4:1). Il est possible que le peuple de Benjamin se soit
prosterné à plusieurs reprises dans un profond respect mêlé de crainte
quand Benjamin prononça le Saint Nom de Dieu, comme le faisaient, selon la
Mishna, les Israélites en entendant le tétragramme7.
Actes rituels
Les professeurs Welch et Szinc nous invitent aussi à nous imaginer les
actes rituels qui accompagnent les mots prononcés. Par exemple, les
allusions au sang expiatoire dans Mosiah 3:15-16 et 4:2, ont
vraisemblablement trait au sacrifice pratiqué au cours du rituel. De même
c’est probablement au moment où l’on accomplit le rituel du bouc émissaire
que l’on parle de chasser l’âne dans Mosiah 5:148.
On pourrait se dire que c’est là ajouter suffisamment de complexité à
notre lecture. Pourtant il y a plus. Le professeur Welch renvoie à une
étude des discours d'adieu antiques dans laquelle l'auteur démontre
l’existence d’une structure idéalement constituée de vingt éléments9.
Quand on le compare à ces discours d’adieu antiques, celui
de Benjamin satisfait mieux aux conditions que le meilleur cité dans
l'étude.
Plus récemment encore, plusieurs érudits mormons ont relevé l'importance
du contexte du temple. Dans un essai publié dans
Glimpses of Lehi’s Jerusalem (aperçus
de la Jérusalem de Léhi), j'ai écrit :
« La caractéristique la plus visible du temple de Jérusalem concerne les
niveaux croissants du sacré, de la cour intérieure vers le lieu saint et
le saint des saints. Selon Mircea Eliade, les trois parties du temple de
Jérusalem correspondent aux trois régions cosmiques. La cour inférieure
représente les régions inférieures (le « Schéol », demeure des morts), le
lieu saint représente la terre, et le saint des saints représente le ciel.
Le temple est toujours le point de rencontre du ciel, de la terre et du
monde des morts.
La cosmologie de Léhi voyait le monde dans ces trois domaines (le ciel, 1
Néphi 1:8, la terre, 1 Néphi 1:14 et le royaume des morts, 2 Néphi 1:14).
Le roi Benjamin, parlant depuis son temple, voit aussi le cosmos en termes
de ciel, de terre et de royaume des morts (Mosiah 2:25, 26, 41), avec
l'entrée dans la présence de Dieu comme l'état joyeux ultime (Mosiah
2:41).
Le peuple de Benjamin se rend au Temple pour qu’on lui ouvre les yeux et
les oreilles afin qu’il puisse recevoir les mystères de Dieu (Mos. 2:9).
Il reçoit un Nom (Mos. 1:12). Il écoute un exposé sur la création (Mos.
2:23) et la chute d'Adam (Mos. 3:11). Il est mis en garde contre le danger
de suivre l'esprit malin (Mos. 2:37) et reçoit un message d'un ange, un
vrai messager (Mos. 3:2). On lui parle de l'expiation salvatrice du Christ
(Mos. 4:6), on lui dit de prier (Mos. 4:11) et de garder les commandements
par alliance (Mos. 5:8), de veiller spirituellement et temporellement les
uns sur les autres (Mos. 4:21). Ils naissent tous de nouveau «fils et
filles » du Christ (Mos. 5:7).
Nouvelles découvertes
Et on continue à faire des découvertes. Dans un nouvel essai, Alyson Von
Feldt constate que le discours du roi Benjamin est « structuré de la même
façon que les Proverbes : il est composé de plusieurs sections séparées
par des ruptures ou des intermèdes cérémoniels10.
», Elle montre que « tout au long de son discours, le roi Benjamin évoque
des thèmes bien connus des Proverbes11.
Enfin, elle montre que « les similitudes thématiques et
littéraires entre Mosiah 1-5 et Proverbes 1-9 argumentent en faveur de la
possibilité que Proverbes 1-9 ait une importance rituelle.
Il se peut que les instructions, comme le discours du roi Benjamin, aient
fait partie d'une liturgie récitée lors d'une cérémonie antique du temple.
Dans ce scénario, la Sagesse est représentée comme une grande prêtresse
qui invite les affamés spirituels à participer à une fête rituelle à sa
table du temple — un festin d'ordonnances, de connaissance et de
bénédictions12.
»
J'ai aussi lu dans des commentaires en ligne que des mésoaméricanistes
mormons ont comparé des éléments du discours du roi Benjamin à des
peintures murales mésoaméricaines récemment découvertes dans des temples
qui datent d’une époque proche du temps de Benjamin, pas loin de la zone
que la plupart des érudits mormons considèrent comme le cadre le plus
probable des événements du Livre de Mormon.
Dans un traitement sur le contenu des peintures murales, Laura Harbold,
une spécialiste non mormone, écrit :
« Les peintures murales, qui illustrent le mythe de la création maya,
courent le long de deux murs de la chambre qui a neuf mètres sur quatre.
‘Une des choses appréciables dans ces peintures murales est qu'elles
impliquent une sorte de tradition narrative, dit Saturno. Cela ressemble à
un livre accordéon maya déplié et peint sur le mur. On voit les sauts de
page ; on peut dire où est la gouttière. » Parce que les peintures murales
représentent une tradition épique cyclique, dit Saturno, on peut commencer
dans n’importe quel coin et lire de gauche à droite.
« Selon Karl Taube, iconographe pour le projet San Bartolo, les peintures
murales représentent une version ancienne d'un mythe qui a dominé la
culture maya pendant quinze cents ans. Dans la première scène, un homme se
tient dans l'eau, sacrifiant un poisson à la principale divinité oiseau,
qui est perchée dans le premier « arbre du monde ». Dans la deuxième
scène, un homme se tient sur le sol, offrant un cervidé à un deuxième
oiseau dans le deuxième arbre du monde ; dans le troisième, il flotte dans
l'air, présentant une dinde ; dans le quatrième, il plane dans un champ de
fleurs, offrant de l'encens. Les quatre arbres représentent les quatre
points cardinaux ou niveaux du cosmos : le monde souterrain, la terre, le
ciel et l'au-delà.
« Dans la scène finale, le dieu maya du maïs se tient devant un cinquième
arbre du monde, constituant le centre de l'univers. La divinité oiseau est
couchée, tuée, au bas de l'arbre, liquidée pour son arrogance et sa
vanité. Le dieu du maïs se couronne roi, portant une coiffure faite avec
le corps de l'oiseau. L'échafaudage en bois sur lequel il est assis, dit
Taube, est le même trône qui est représenté depuis des siècles dans le
couronnement des rois mayas.
« Une autre série de peintures murales représente le cycle de vie du dieu
du maïs — sa naissance dans l'eau, sa sortie de la terre portant la
moisson, sa mort représentée par sa plongée dans l'eau et sa résurrection
et son second couronnement. ‘Le récit tout entier conduit au couronnement
d'une personne nommée’, dit Saturno, établissant le dieu du maïs comme le
fondement de la royauté maya13. »
Ceux qui connaissent bien le récit du roi Benjamin relèveront la mention
de la tour associée au couronnement (voir Mos. 2:7). Autre détail
intéressant : la mention des « livres accordéon » mayas
qui sont « dépliés ». Les érudits
mormons ont nous invités à nous rappeler que Benjamin dit à la multitude
présente que « les mystères de Dieu soient dévoilés à votre vue » (voir
Mos. 2:9).
Les professeurs Szinc et Welch ont comparé les allusions à « le chasse et
l’expulse » (Mos. 5:14) à ce qui se fait lors du rituel du bouc émissaire
le jour des Expiations. Ce qui, à son tour, fait penser à l'image du dieu
oiseau battu à San Bartalo. Aucun de ces parallèles ne devrait être
considéré comme une preuve, mais comme la démonstration que les éléments
et les thèmes principaux du récit de Mosiah sont tout à fait à l’aise
aussi bien avec les racines dans l'ancien Israël, que dans le contexte
américain antique dont il se réclame.
Le professeur Allen Christenson écrit ceci sur les fêtes maya de la
moisson par comparaison avec les récits du Livre de Mormon.
« Le discours de Benjamin ressemble beaucoup au schéma méso-américain
antique des fêtes de la moisson au cours desquelles le dieu de la vie, ou
son représentant terrestre, descend aux enfers et est accablé par les
puissances maléfiques de la mort et du sacrifice. Benjamin commence par
déclarer au peuple qu'il a l’intention de dévoiler « les mystères de
Dieu... à [leurs] yeux » (Mosiah 2:9). Il annonce sa mort imminente et sa
« descente » dans la tombe (Mosiah 2:26-30). Il avertit le peuple de se
méfier, en son absence, de « l’esprit malin », l’ « ennemi de toute
justice », l’ « ennemi de Dieu » qui apporte la destruction sur l'humanité
(Mosiah 2:32-33, 37-38).
C'est précisément la descente du roi dans le monde souterrain dans la fête
méso-américaine, à la fin de l'année civile qui permet aux forces de la
mort et du mal de régner sur la terre. Bien que cela ne soit
habituellement qu’une mort rituelle temporaire de la part du roi, la
perspective de sa mort réelle était source d’une grande préoccupation14.
Planter la bonne semence
Ce type de mise en contexte augmente mon appréciation et approfondit ma
compréhension du texte. Il m'aide à apprécier à quel point la traduction
du Livre de Mormon a été miraculeuse. Je ressens l'urgence qui se rattache
à la question toute simple d’Alma quand il parle de ce qui se passe
lorsque nous plantons une bonne semence, que nous la sentons grandir, nous
gonfler l’âme, éclairer notre intelligence, nous épanouir l’âme. « Cela
n’est-il pas réel ? » demande-t-il (Alma 32 :35).
Il y aura, bien entendu, des détracteurs qui répondront : « Non », en
affirmant, par exemple, que c’est Joseph Smith qui a composé le discours
sur la base de son expérience des « réveils » religieux du Burnt-Over
District [surnom donné à la région de Palmyra à cause du grand nombre de
réveils religieux qui s’y produisirent au début du XIXe siècle]. Par
exemple, l’un d’eux affirme que « le point culminant du récit... dépend...
fondamentalement d’un schéma non biblique contemporain de Smith15.
Il voit ce schéma en quatre étapes comme suit : « (1) réunion de
réveil religieux (Mosiah 2) ; (2) prosternation dans un esprit de
culpabilité (4:1-2a) ; (3) supplique pour une émancipation spirituelle (v.
2 b) ; et (4) absolution christologique et extase émotionnelle (v. 3)16. »
On remarquera que quand il crée les étiquettes pour ce schéma en quatre
étapes, il utilise un langage conçu pour évoquer le cadre du XIXe siècle
et néglige le vocabulaire du texte du Livre de Mormon. Par exemple, dans
Mosiah, le rassemblement est centré sur la déclaration de Benjamin que
Mosiah doit lui succéder comme roi (Mosiah 1:10). On serait bien en peine,
et c’est le moins qu’on puisse dire, de trouver un réveil religieux dans
le Burnt-Over District réuni devant un temple dans le but d'annoncer la
succession du roi suivant17.
La raison pour laquelle le peuple « tombe » dans Mosiah se retrouve dans
des contextes théologiques rituels distincts. La supplique pour appliquer
le sang expiation du Christ a autant sa place dans un cadre antique que
dans un quelconque scénario du XIXe siècle. Le travail que Margaret Barker
est en train de faire pour redécouvrir la Théologie du Temple a ouvert de
nouveaux horizons permettant de reconsidérer l’affirmation fréquente que
le Livre de Mormon (et, par conséquent, Benjamin), est trop chrétien avant
le Christ18.
Et la quatrième étape peut correspondre non seulement aux récits de
conversion du XIXe siècle, mais aussi aux témoignages de conversion tout
au long de l'histoire et dans de nombreuses cultures19.
À ce jour, aucun des détracteurs qui ont prétendu que Mosiah 1-5 était un
texte du XIXe siècle ne s’est attaqué à l'accumulation des études que j'ai
mentionnées ici. Bien que l’on puisse voir dans le Livre de Mormon un
simple écrit du XIXe siècle, la véritable question est de savoir si c'est
la meilleure explication. Pour pouvoir dire ce qui est le « meilleur », il
faut se livrer à des comparaisons approfondies avec les autres
possibilités et énoncer clairement les éléments sur la base desquels on
décide de ce qui est le « meilleur ».
Déjà en 1953, Hugh Nibley expliquait :
« Mais comment peut-on être certain de quoi que ce soit quand on critique
le Livre de Mormon ? C’est Blass qui nous donne la réponse : ce qui nous
permet d’approcher le plus d’une certitude, dit-il, c’est de disposer d’un
long document historique, car il est ‘hautement improbable et doit donc
être considéré en tout temps comme exclu qu'un faussaire venant plus tard
[que la date à laquelle le document est censé avoir été rédigé] puisse
avoir la connaissance et la diligence nécessaires pour présenter une
quantité quelconque de données historiques sans tomber dans des
contradictions.’ À cet égard, le moyen sûr par excellence de détecter un
faussaire, nous dit notre guide, se trouve dans les choses qu'il ne peut
pas avoir bien réussi à imiter parce qu'elles étaient trop négligeables,
trop insignifiantes et trop embêtantes à reproduire.
« Dans Léhi dans le désert
nous disions : Le test d'un document historique se situe, comme nous avons
si souvent insisté, non pas dans l'histoire qu’il raconte, mais dans les
détails occasionnels que seul un témoin oculaire peut avoir vus. C'est
dans ces détails accessoires et qui passent inaperçus que le Livre de
Mormon brille20. »
Comme quand on regarde une fractale
Pour moi, examiner le discours de Benjamin c’est comme regarder une
fractale. Plus je regarde de près diverses études telles que celles que
j'ai mentionnées ici, plus je découvre de complexité. Cela me donne le
sentiment que le texte est « réel », qu'il donne un discours réel par une
personne réelle à un auditoire réel dans un contexte plausible21.
« L'emplacement de Zarahemla, dans la vallée du fleuve Grijalva22,
non seulement correspond à la géographie et à la topographie, mais
relie les grands groupes linguistiques. Les Néphites sont entrés dans une
zone de langue maya. Les Mulékites sont entrés dans une zone de langue
mixe-zoque. La montée des Mulékites/Zarahemlaïtes dans la vallée du
Grijalva est en parallèle avec le mouvement bien connu du zoque (une
langue dérivée du mixe-zoque) pour remonter cette vallée.
« C'est ce qui explique pourquoi les Néphites et les Zarahemlaïtes
parlaient des langues différentes alors qu’il n'y avait pas suffisamment
de temps pour que leur langue s’écarte suffisamment de l'hébreu pour
devenir incompréhensible. (En quatre cents ans seulement certains mots
auraient changé, mais les langues auraient encore été mutuellement
intelligibles)23. »
Cela fait aussi penser aux commentaires du professeur Midgley dans le
premier numéro de la
Review of Books on the Book of Mormon :
« De mon point de vue, le Livre de Mormon signale qu’il se passe beaucoup
plus dans le rétablissement réalisé grâce à lui que simplement une façon
maladroite de fournir un assortiment aléatoire de perles théologiques que
nous pouvons intégrer dans notre propre schéma.24. »
Le discours de Benjamin est souvent traité comme un recueil de « joyaux
théologiques » que nous lisons sans tenir compte de leur propre contexte.
Bien que nous devions tous commencer quelque part dans notre appréciation,
et qu’il y ait quelques beaux passages que nous pouvons facilement traiter
comme des « joyaux » à citer, nous devons également faire un effort
concerté pour laisser le texte nous dire ce que nous ne savons pas déjà.
Il est trop facile de sauter jusqu’aux extraits que nous reconnaissons et
sur lesquels nous pouvons alors discourir facilement. Et cependant, si une
partie du message du texte est qu’il est réel, nous devrions être d’autant
plus sensibilisés pour découvrir ce qu'il dit réellement.
À titre d’exemple, je me réfère à un livre de Colleen Harrison,
He Did Deliver Me From Bondage.
Une des nombreuses idées intéressantes qu’elle propose concerne le
problème de la « dyslexie spirituelle ». La dyslexie est une affliction
qui amène le sujet à percevoir les mots et les lettres en sens inverse.
Comme exemple de dyslexie spirituelle assez courante chez les saints des
derniers jours, elle cite ce passage dans Mosiah 4:14 :
« Et vous ne souffrirez pas que vos enfants soient affamés ou nus; et vous
ne souffrirez pas non plus qu'ils transgressent les lois de Dieu, et se
battent et se querellent… »
Elle fait remarquer qu'il s'agit d'un passage qui peut être très frustrant
pour des parents si on le lit hors contexte.
« Lu en contexte, Mosiah 4:14 n'est pas une obligation ou un commandement.
C'est en fait une promesse25 ! »
C’est-à-dire que, plutôt que d’interpréter de manière incorrecte la
promesse comme un commandement et d’essayer de forcer nos enfants à se
soumettre aux lois de Dieu, d’empêcher toutes leurs bagarres et leurs
querelles en n’ayant recours qu’à une domination « juste », elle trouve
qu'en s’efforçant de laisser le Christ entrer dans son cœur selon les
recommandations de Mosiah 4 :
« Je me suis aperçue que j’étais naturellement encline à aimer et à
accepter, à être à l'écoute des sentiments et des besoins de mes enfants…
Quand j'ai changé, mes enfants ont commencé à changer. Ma capacité à
‘marcher dans les voies de la vérité et de la sagesse’ les a amenés à
devenir, eux aussi, plus honnêtes et plus sages. Leurs excès de mauvaise
conduite ont commencé à diminuer en même temps que les miens. Cela a été
une leçon pour moi de constater qu'une grande partie de la
confusion et des conflits qu’il y avait chez eux venait de mon propre
comportement26. »
En étudiant Mosiah, je trouve beaucoup de ce qu'Alma appelle des « raisons
de croire ». La force de ma croyance devrait m'amener à laisser la parole
du Christ grandir dans mon cœur, me changer de sorte que je puisse
recevoir les bénédictions promises. Puis en faisant ce qu’il a dit, je
peux progresser comme disciple et véritablement connaître non seulement la
vérité, mais laisser cette vérité apporter la liberté du Christ dans ma
vie.
Pour ma part, j'ai appris que quand je tombe sur des questions pour
lesquelles je n'ai pas de réponses, ma meilleure réponse est 1) donner du
temps aux choses, 2), garder les yeux ouverts et 3) réexaminer
périodiquement mes idées reçues.
Notes
1
John W. Welch et Terry Szinc, "King Benjamin's Speech," p. 202 note 3,
dans John W. Welch et Stephen D. Ricks., dirt. de publ.,
King Benjamin’s
Speech: That Ye May Learn Wisdom, Provo, FARMS, 1998,
2
Hugh Nibley, “An Approach to the Book of Mormon », 2e éd. Salt Lake
City, page 243.
3
John Tvedtnes, “King Benjamin and the Feast of Tabernacles”, dans
John M. Lundquist et Stephen A. Ricks, dir. de publ.,
By Study and Also
By Faith, tome 2, Salt Lake City, Deseret Book, 1990, pp.
197-237.
Plus récemment, Diane Wirth a exploré les parallèles entre la fête des
Tabernacles et la cérémonie Cha-Cha’ac des Mayas. Voir
Decoding
Ancient America: A Guide to the Archeology of the Book of Mormon,
Springville, Horizon, 2007, “Parallels Between Hebrew and Nephite
Festivals », pages 27-33.
4
John W. Welch Parallelism and Chiasmus in King Benjamin's Speech", pp.
315-410 dans John W. Welch et Stephen D. Ricks.,dir. de publ.,
King Benjamin’s
Speech: That Ye May Learn Wisdom, Provo, FARMS, 1998.
5
Stephen D. Ricks, “Kingship, Coronation, and Covenant” in Mosiah 1-6” dans
King
Benjamin’s Speech, 233-275.
6
Gordon C. Thomasson, “Mosiah: The Complex Symbolism and Symbolic Complex
of Kingship in the Book of Mormon” dans
Journal of Book of
Mormon Stories, vol 2 n 1, pages 21-38.
7
Welch et Szinc, “King Benjamin’s Speech in the Context of Ancient
Israelite Festivals”, p. 179.
Existe en français dans Idumea, Le discours du roi Benjamin dans le
contexte des fêtes israélites anciennes.
8
Welch et Szinc, “King Benjamin’s Speech in the Context of Ancient
Israelite Festivals”, p. 178.
9
John W. Welch, “Benjamin’s Sermon as a Traditional Ancient Farewell
Address”, dans
King
Benjamin’s Speech, pp. 89-118.
10
Alyson Skabelund Von Feldt, “His Secret is With the Righteous:
Instructional Wisdom in the Book of Mormon,” FARMS Occasional Papers, n 5,
Provo, FARMS, 2007, p 68.
11
Id., p. 69.
12
Id. p. 72.
13
http://www.neh.gov/news/humanities/2006-11/Portrait_of_the_Past.html,
visité le 27 avril 2008.
14
Allen J. Christenson, “Maya Harvest Festivals and the Book of Mormon,”
dans Review of
Books on the Book of Mormon vol 3 1991. page 28.
15
Brent Lee Metcalfe “The Priority of Mosiah: A Prelude to Book of Mormon
Exegesis” dans
New Approaches to
Book of Mormon Study: Explorations in Critical Methodology,
Salt Lake City, Signature Books, 1993, p. 421 n. 31.
16
Id.
17
Voir mon étude dans “Paradigms Crossed” dans
Review of Books on
the Book of Mormon, tome 7, n2, pp. 174-176.
Plus récemment, Grant Palmer, dans
An Insider’s View
of Mormon Origins, Salt Lake City, Signature Books, 2002,
parle du même schéma en quatre étapes, citant non pas la version
précédemment publiée de Metcalfe, mais une correspondance personnelle.
Il renvoie à un discours d’adieu donné lors d’un réveil religieux par un
certain évêque M’Kendree, qui peut se comparer à Mosiah 1-5, mais qui ne
mentionne aucune comparaison antique, ce qui jette le doute sur sa
prétention à être quelqu’un qui connaît les choses de l’intérieur.
18
Voir le traitement sur son site
http://www.margaretbarker.com/
et mes essais sur le site de Howard Hopkin à cette adresse :
http://www.thinlyveiled.com/.
19
Voir Stanislav et Christina Grof,
Beyond Death: The
Gates of Conciousness,
Londres, Thames and Hudson, 1990, pp. 28-30.
20
Hugh Nibley,
The Prophetic Book of Mormon, The Collected Works of Hugh Nibley
Vol 8, Provo et Salt Lake City, FARMS et Deseret Book, 1989, pp. 58-59
21
On trouvera une proposition d’emplacement pour Zarahemla dans John
Sorenson, An Ancient American
Setting for the Book of Mormon (Salt Lake City, Deseret Book et FARMS,
1985, pp. 148-161.
Le livre existe en traduction française sur idumea.org.
22
Pour voir pourquoi le fleuve Grijalva est le seul fleuve d’Amérique qui
correspond à la description du Sidon que fait le texte du Livre de Mormon,
voir la page de Larry Poulson à cette adresse :
http://www.poulsenll.org/bom/grijalvasidon.html
23
Brant Gardner, cité dans Kevin Christensen, “Truth and Method”, dans FARMS
Review 16:1.
24
Louis Midgley, “Prophetic Messages or Dogmatic Theology” dans
Review of Books on
the Book of Mormon, vol 1, page 93.
25
Collen Harrison,
He Did Deliver Me
From Bondage, 2e éd., Pleasant Grove,Windhaven, 2002,
A-9.
26
Id., A20-A21. |