|
De temps à autre, des
personnes se posent la question de savoir ce que sont devenues les tribus
perdues que le Sauveur doit ramener des pays du nord (D&A 133:26). Cela
nous incite à afficher l’article suivant qui, bien que technique, vaut la
peine d’être lu à cause des possibilités intéressantes qu’il propose et
parce que l’auteur est particulièrement qualifié de par sa spécialisation
en allemand et en hébreu.
SUR LES TRACES DE LA
DISPERSION
De nouvelles études de
linguistique nous fournissent une pièce à verser au dossier de la
dispersion d’Israël
par Terry M. Blodgett [1]
Ensign, février 1994, pp.
64-70
Traduit et affiché avec la
permission du Church Copyright and Permissions Office
Qu’est-il advenu, il y a bien
des siècles, des tribus constituant le royaume d’Israël ? Voilà des
générations que ceux qui étudient l’Évangile se posent la question. Comme
tout sujet historique important, celui-ci mérite d’être étudié avec le
plus grand soin.
Reconstituer l’histoire
ancienne, même l’histoire religieuse, c’est comme assembler un puzzle
complexe aux nombreuses pièces, dont beaucoup sont manquantes. On doit en
trouver et en assembler le plus possible et ensuite se faire une idée
aussi précise du passé que les faits le permettent. Ainsi donc, quand on
veut suivre les traces de la dispersion d’Israël, il faut tenir compte de
nombreux éléments : objets, vestiges de coutumes anciennes, archéologie,
anthropologie culturelle et récits scripturaires et historiques. Le
présent article n’examine qu’un seul de ces éléments : les données
linguistiques [2].
Toutes les langues évoluent
Une langue est un phénomène
culturel dynamique. Elle change et se développe. De nos jours, la
technologie moderne, les sciences et les médias ont accéléré l’acquisition
de nouveaux mots, mais en même temps, ils ont standardisé l’orthographe et
la prononciation. Dans le passé, les langues acquéraient plus lentement
des nouveaux mots, mais elles avaient plus de chances de connaître des
changements d’orthographe et de prononciation.
Une des grandes causes de
changement dans une langue est la rencontre de deux groupes parlant chacun
une langue différente. Chacune d’elles influence l’autre, devenant ainsi
le catalyseur du changement et finissant par adopter des structures
caractéristiques des langues qui sont à l’origine des changements. Ces
structures sont des indices qui aident le linguiste à dire à quoi
ressemblait la langue avant que les changements ne se produisent et
quelles sont les langues qui ont provoqué les changements.
La conclusion fondamentale de
l’étude linguistique de ce sujet est que lorsque des groupes importants
d’Israélites ont jadis quitté leur patrie – d’abord à la suite de la
captivité assyrienne d’Israël ou royaume du nord (vers 700 av. J.C.) et de
la captivité babylonienne de Juda ou royaume du sud (vers 600 av. J.-C.),
et ensuite, après la conquête romaine de la Palestine (vers 70 de notre
ère) – leur langue a influencé celle de certains des pays vers lesquels
ils ont émigré. Ces éléments linguistiques peuvent nous aider à déterminer
où certains de ces Israélites sont allés et vers quelle époque. Bien que
les anciens Israélites aient finalement été dispersés dans le monde entier
(voir Amos 9:9), il y a au moins une grande région géographique qui
contient des traits linguistiques importants donnant à penser que des
migrations israélites s’y sont bien produites. Cette région, c’est
l’Europe.
Faits linguistiques en Europe
L’Ancien Testament et d’autres
sources historiques telles que les annales des rois assyriens nous
apprennent que le royaume du nord, après des années de guerre et de
déportation, est tombé sous les coups des envahisseurs assyriens en 721
av. J.-C. Jérémie a souligné que les pays du nord étaient la destination
finale de ces Israélites (voir Jé. 3:12–18; 16:14–16; 23:7–8) et fait
supposer un itinéraire vers l’ouest (voir Jé 18:17; Os 12:1). Il est donc
tout naturel de rechercher ce qu’il est advenu de ces restes dans les pays
situés au nord et à l’ouest du Proche-Orient.
On sera donc intéressé
d’apprendre qu’en Europe, les siècles qui ont suivi 700 av. J.-C. ont été
marqués par une énorme influence extérieure et que la langue en a été
profondément influencée. Pendant la période allant de 700 à 400 av. J.-C.,
de nombreuses langues d’Europe ont subi des changements de prononciation
majeurs et ont absorbé un vocabulaire nouveau [3]. Cela a particulièrement
été le cas des langues celtes, qui étaient parlées, à l’origine, partout
en Europe (700-300 av. J.-C.), mais se sont graduellement concentrées
davantage en Europe occidentale et en Grande-Bretagne, et des langues
germaniques, qui étaient parlées en Europe centrale, en Europe du Nord et
en Scandinavie et finalement en Angleterre. L’évolution graduelle des sons
qui constituent les mots dans une langue, en particulier quand deux
langues fusionnent, est appelée mutation consonantique par les linguistes.
Les changements de prononciation bien connus de la période de 700 à 400
av. J.-C. ont été appelés la première mutation consonantique germanique,
parce que c’est dans les langues germaniques (anglais, néerlandais,
allemand, danois, suédois, norvégien et islandais) qu’ils ont été les plus
prononcés et les plus systématiques [4]. En outre, au cours de cette même
période, le vocabulaire total des langues germaniques s’est accru d’un
tiers [5].
Les linguistes se sont
longtemps demandé ce qui a causé la mutation consonantique et
l’accroissement du vocabulaire [6]. Selon une théorie, les populations
techniquement avancées qui ont introduit le fer en Europe (7e siècle av.
J.-C. en Autriche, 6e siècle av. J.-C. en Suède) ont également influencé
les changements de langue. Les recherches linguistiques soutiennent cette
idée ainsi que l’idée que ces populations plus avancées venaient du
Proche-Orient, où le fer était en usage. Les recherches montrent que les
changements linguistiques ont été le résultat d’un afflux de peuples de
langue hébraïque en Europe, en particulier dans les régions de langue
germanique et celtique.
La première mutation consonantique germanique
La plupart des langues
d’Europe appartiennent à la famille des langues indo-européennes,
c’est-à-dire qu’elles font partie du groupe de langues linguistiquement
apparentées parlées en Europe et s’étendant dans l’est jusqu’en Iran et en
Inde. Pendant de nombreuses années, les particularités propres aux langues
germaniques ont empêché les linguistes de se rendre compte que les langues
germaniques appartenaient au groupe indo-européen. Mais au début du 19e
siècle, deux linguistes, Rasmus Rask du Danemark (1818) et Jakob Grimm
d’Allemagne (1819-1822), ont montré que les langues germaniques faisaient
effectivement partie de la famille indo-européenne mais que leurs
différences de prononciation étaient causées par une mutation systématique
dans le son de deux groupes de consonnes, [p, t, k] et [b, d, g]
[7].
À l’époque de la première
mutation consonantique, la prononciation de ces six consonnes est devenue
[ph, th, kh] et [bh, dh, gh], respectivement. Ces nouveaux
sons ont été habituellement représentés par écrit par les lettres f,
th, h (x ou ch) et b (v), d (th),
g (gh). Par exemple, en appliquant les règles de la mutation
consonantique à l’indo-européen te puk – en remplaçant t, p
et k par th, f et x – nous reconnaissons les mots
anglais the fox. Maintenant le rapport entre le mot indo-européen
pater et le mot anglais father devient plus reconnaissable.
D’une manière générale, les
linguistes s’accordent pour dire que ces changements ont commencé à se
produire à un moment donné après 700 av. J.-C. et que l’influence qui a
causé la première mutation consonantique a continué à affecter les
dialectes germaniques pendant plusieurs siècles, au moins jusqu’en 400 av.
J.-C., peut-être même jusqu’à l’ère chrétienne [8].
Malheureusement, les
spécialistes n’ont pas pu se mettre d’accord sur ce qui a causé ces
changements ni sur la patrie d’origine de ces populations. Ils les font
remonter jusqu’à la région de la mer Noire et aux monts Caucase, mais les
recherches n’ont pas pu aller au-delà, parce que les spécialistes ne
savaient pas si cela avait été la patrie d’origine de ces gens ou s’ils
étaient venus de l’est ou du sud par rapport à cet endroit. Mes recherches
m’ont conduit au Proche-Orient et c’est là que j’ai trouvé la cause
probable de la première mutation consonantique : l’hébreu.
La première chose que j’ai
remarquée, c’est que l’hébreu changeait les six mêmes consonnes que le
germanique : [p, t, k] et [b, d, g]. Dans l’hébreu ancien,
ces consonnes avaient une prononciation double. Souvent elles ne
changeaient pas, mais quand elles étaient au début d’une syllabe précédée
d’une voyelle longue ou finissaient une syllabe, [p, t, k] et [b,
d, g], elles se prononçaient [ph, th, kh] et [bh, dh, gh].
C’est ainsi que le mot hébreu désignant l’Espagne, separad, était
prononcé sepharadh, et le mot signifiant « signe », écrit ‘ot,
était prononcé ‘oth.
En 700 av. J.-C., cette
mutation consonantique fonctionnait toujours en hébreu et devait faire
partie de l’impact que des émigrants Israélites ont pu avoir sur d’autres
langues. Le fait que ce sont les mêmes consonnes qui sont affectées, à peu
près au même moment, dans des mutations consonantiques semblables dans les
dialectes hébraïques et germaniques est significatif. Ce qui est encore
plus significatif, c’est que les sons [ph, th, kh] et [bh, dh,
gh], si courants en hébreu, n’existaient pas en germanique avant la
première mutation consonantique [9].
Comparaison entre l’hébreu et le germanique
La thèse de l’influence
hébraïque sur le germanique est encore renforcée par la comparaison
soigneuse des deux langues et, en particulier, des changements qui se sont
produits dans le germanique après la captivité assyrienne d’Israël. Les
changements se répartissent d’une manière générale en trois catégories :
prononciation, grammaire et vocabulaire.
Prononciation.
Outre la similarité des mutations consonantiques que nous venons de
décrire, il y avait d’autres sons communs à l’hébreu et au germanique qui
n’apparaissaient généralement pas dans les langues indo-européennes. Par
exemple, quand des consonnes hébraïques et germaniques apparaissaient
entre des voyelles, elles étaient normalement doublées si la voyelle
précédente était brève. Ce doublement des consonnes, appelé gémination,
est devenu une caractéristique des langues germaniques, mais pas des
autres langues indo-européennes. C’est ainsi que l’indo-européen media
est devenu middel en vieil anglais et middle en anglais
moderne.
Près de la moitié de la
conjugaison des verbes en hébreu demandait le doublement de la consonne et
le raccourcissement de la voyelle précédant la consonne. Comparez l’hébreu
shaba (« casser ») et la forme hébraïque apparentée shibber
(« briser, fracasser »). De même, près de la moitié des verbes germaniques
ont doublé la consonne du milieu et ont raccourci la voyelle précédente :
l’indo-européen sad- et bad- sont devenus settan («
set ») et beddan (« bid ») en vieil anglais .
Grammaire.
À l’époque de la première mutation consonantique germanique, les dialectes
germaniques ont connu une réduction brutale dans le nombre des cas
grammaticaux, rapprochant le germanique de l’hébreu. Comme en anglais, le
cas (ou forme) d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif dans une langue
germanique indiquait sa relation grammaticale avec d’autres mots d’une
phrase. À l’époque de la première mutation consonantique germanique, les
dialectes germaniques ont immédiatement réduit le nombre des cas possibles
de huit à quatre pour un mot (comme en allemand moderne) et finalement à
trois (comme en anglais, en espagnol et en français). C’étaient les trois
mêmes cas (avec les restes possibles d’un quatrième) que l’hébreu
utilisait avant les captivités assyrienne et babylonienne – le nominatif
(indiquant qu’un mot est le sujet d’une phrase), l’accusatif (indiquant
qu’un mot est le complément d’un verbe ou d’une préposition) et le
génitif (utilisé pour indiquer un mot à la forme possessive) [10].
L’indo-européen avait six
temps verbaux. L’hébreu, de son côté, n’avait que deux temps (ou aspects),
traitant d’actes soit achevés soit inachevés. De la même manière, le
germanique a réduit le nombre de ses temps à deux : le passé et le
présent. Les autres temps utilisés dans les langues germaniques modernes
découlent de la combinaison de ces deux temps originels.
Les formes verbales des deux
groupes de langues comportent aussi des ressemblances. Le verbe hébreu
kom, kam, kum, yikom (« se lever »), par exemple, peut être comparé
avec l’anglais moderne come et came, le vieil anglais
cuman et l’allemand kommen, kam, gekommen (« venir, arriver, se
produire ») .
Vocabulaire.
La ressemblance la plus convaincante entre
l’hébreu et le germanique réside sans doute dans leur vocabulaire commun.
Les linguistes reconnaissent que le tiers environ du vocabulaire
germanique n’est pas d’origine indo-européenne [13]. On peut remonter la
piste de ces mots jusqu’à la période protogermanique de 700-100 av. J.-C.,
mais pas au-delà. Chose significative, ce sont des mots qui rappellent,
tant par la forme que par la signification, le vocabulaire hébreu. Une
fois qu’une formule a été élaborée pour comparer les vocabulaires
germanique et hébraïque, le nombre de mots ressemblants que l’on peut
identifier dans les deux langues s’est rapidement chiffré par milliers.
Selon cette formule, les mots
introduits dans le germanique après 700 av. J.-C. avaient tendance à
modifier leur orthographe de trois façons.
Premièrement, dans la plupart
des dialectes germaniques, les mots ont changé d’orthographe conformément
à la mutation consonantique. Par contre, l’hébreu n’a changé que dans la
prononciation ; l’orthographe est restée la même. Par exemple, l’hébreu
parah (« s’avancer rapidement, voyager ») est resté parah dans
l’écriture, mais était prononcé [fara] s’il était précédé d’une
voyelle longue qui lui était étroitement associée. Quand on se souvient de
cela, il est facile de reconnaître ce mot en vieux norrois et en vieux
frison (dialecte des Pays-Bas) : fara (« voyager, se déplacer
rapidement »).
Deuxièmement, les voyelles des
syllabes initiales étaient souvent supprimées dans les formes écrites du
germanique parce que les mots hébreux avaient généralement l’accent sur la
dernière syllabe. Comparez l’hébreu daraq avec l’anglais drag.
De temps à autre, si la consonne initiale était faible, la syllabe tout
entière tombait, comme dans l’hébreu walad (« progéniture
masculine, fils ») et l’anglais lad et dans l’hébreu nafal
(« tomber ») et l’anglais fall.
Troisièmement, l’hébreu
utilisait un accent tonal (insistance vocale consistant en un ton ou un
son dans une partie d’un mot) plutôt qu’un accent tonique (accentuation
vocale consistant en un accroissement de volume dans l’expression d’une
partie d’un mot), mais cela se transformait en accent tonique dans les
dialectes germaniques. Toutefois, les effets de l’accent tonal hébreu sont
manifestes en germanique. Le ton hébreu, qui apparaissait habituellement
dans la syllabe finale, était souvent représenté dans le germanique écrit
par une des quatre lettres tonales l, m, n, ou r. Comparez
l’hébreu satat (« placer, fonder, baser, commencer ») avec
l’anglais start (le r représente le ton hébreu) et l’hébreu
parak (« être libre, libérer ») avec l’anglais frank (« libre,
franc parler », où le p est devenu f, où l’a non accentué a
été supprimé et où n a été ajouté, représentant le ton hébreu).
Les ressemblances dans les
mots hébreux et anglais renvoient à leurs racines communes.
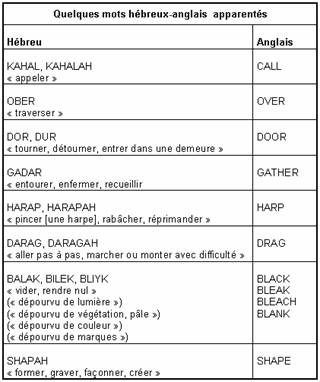
Nouveaux mots germaniques provenant de racines de mots
hébreux
L’hébreu biblique contenait
relativement peut de racines – quelques centaines à l’origine – mais une
grande diversité de mots a été formée à partir de ces racines. La plupart
de ces formations ont été créées en échangeant les voyelles, en ajoutant
des préfixes ou des suffixes et en redoublant les consonnes selon
certaines règles. Littéralement des milliers de mots semblables à ces
racines et aux formes multiples qui sont sorties de ces racines sont
apparus dans les dialectes germaniques entre 700 et 400 av. J.-C. Un
exemple en est l’hébreu dun ou don. La racine est dwn
et est apparentée à la racine ‘adan (« gouverner, juger, descendre,
être bas, région gouvernée ou jugée, domaine »). Le nom propre Dan
(« juge ») est apparenté à cette racine. De cette racine est aussi sorti
le mot hébreu ‘adon (« Seigneur, Maître »). Ces mots nous
rappellent le mot anglo-saxon adun, qui a donné le mot anglais
down (le nom signifie « colline, hautes terres ») et la région
gouvernée était don, ou son équivalent moderne town. Il est
également intéressant de noter que le mot hébreu ‘adon (« Seigneur
») et sa racine ‘adan (« gouverner, juger ») peuvent très bien être
comparés à Odin et à Wodan, deux noms provenant de dialectes
différents et désignant le plus grand des dieux germaniques.
La seconde mutation consonantique germanique
L’influence de l’hébreu sur
les langues germaniques ne se limite par à la première mutation
consonantique de 700-400 av. J.-C. Un millier d’années environ après la
première mutation consonantique, les dialectes germaniques du nord de
l’Italie, de la Suisse, de l’Autriche et du sud de l’Allemagne ont
commencé un second changement phonétique impliquant les six mêmes
consonnes. Commençant dans le sud vers 450 de notre ère, cette seconde
mutation consonantique, également appelée mutation consonantique du haut
allemand (puisqu’elle a commencé sur les hauteurs des Alpes), s’est
répandue vers le nord en Suisse et en Autriche. En 750 apr. J.-C., elle
avait atteint les dialectes du sud de l’Allemagne. Ce dialecte haut
allemand a connu une popularité croissante (au 16e siècle Martin Luther
l’a utilisé dans sa traduction de la Bible) jusqu’à finir par devenir
l’allemand officiel.
La différence principale entre
les deux mutations consonantiques, celle de 700-400 av. J.-C. et celle de
450-750 apr. J.-C. [14], est que le [t], devenu [th] lors de
la première mutation consonantique, est devenu systématiquement [s]
dans la seconde. C’est ce qui a fait que le mot water, par exemple,
a été prononcé wasser et white a été prononcé weiss.
Ce passage du [t] à [s] est une indication importante de ce
qui a été à l’origine de cette seconde mutation consonantique dans le sud
du territoire germanique. Il nous ramène une fois de plus au Proche-Orient
– mais cette fois à l’araméen.
L’influence araméenne
Quand la Perse conquit
Babylone, Cyrus le Grand libéra les prisonniers juifs et leur permit de
retourner dans leur patrie en Palestine. Tous ne voulurent cependant pas
quitter la belle ville de Babylone pour retourner dans leur pays, qui
avait été détruit. Certains restèrent. Beaucoup des tribus de Juda et
Benjamin retournèrent. Ceux qui rentrèrent en Palestine se trouvèrent
entourés de populations de langue araméenne et ils ne tardèrent pas à
adopter l’araméen comme langue de tous les jours [15].
Il en résulte que les Juifs
parlaient araméen en 70 apr. J.-C., lorsque les Romains envahirent
Jérusalem et provoquèrent la fuite de Palestine de milliers de Juifs. Au
cours des années qui suivirent, beaucoup de ces Juifs de langue araméenne
partirent vers le nord, vers l’Europe. Les Juifs christianisés, en
particulier, cherchèrent refuge dans les Alpes italiennes, et dès 450 apr.
J.-C., ils y avaient installé une population importante. Au cours des
siècles qui suivirent, ils se répandirent graduellement vers le nord, en
Suisse, en Autriche et en Allemagne [16].
Les historiens ont bien
documenté ces migrations, mais ils n’ont pas reconnu l’influence de la
langue de ces populations sur celles qu’elles ont rencontrées. L’araméen
avait connu, à l’origine, une mutation consonantique identique à celle de
l’hébreu, mais dès 500 av. J.-C., quand les Juifs l’apprirent, la langue
avait apporté un changement petit mais significatif dans sa prononciation.
L’araméen commença à changer le [t] en [s] plutôt qu’en [th],
comme l’hébreu et l’araméen l’avaient fait précédemment [17].
C’est aussi la différence
caractéristique entre la première mutation consonantique germanique de
700-400 av. J.-C. et la seconde mutation consonantique germanique de
450-750 apr. J.-C. [18]. Par exemple, en comparant les changements
hébreu/araméen avec les première et seconde mutations consonantiques, nous
constatons que les Juifs, à l’époque de leur dispersion, prononçaient, par
exemple, les mots hébreux bayit (« maison ») bayis et
gerit (de gerah, « gruau ») garis. Par comparaison, le mot
germanique correspondant à l’anglais grit (griot, « gruau ») a
connu un changement similaire vers grioz, puis vers griess
pendant la seconde mutation consonantique. Ces changements font penser à
une influence de l’araméen sur les dialectes germaniques du sud. Des mots
de vocabulaire hébreu ont été ajoutés aux dialectes allemands du sud,
autrichiens et suisses au cours de cette période ultérieure (comparez
l’hébreu pered, « bête de somme » avec l’allemand Pferd,
cheval).
Les mutations consonantiques hébraïques
Ainsi donc, ce qu’on a appelé
première et seconde mutations consonantiques germaniques s’avère avoir été
une mutation consonantique hébraïque et une mutation consonantique
araméenne étroitement apparentée qui ont influencé les dialectes
germaniques à deux époques distinctes de l’histoire. Les recherches
montrent aussi que la marque linguistique des mutations consonantiques,
confirmée par d’autres ressemblances linguistiques, en particulier le
vocabulaire, peut être utilisée pour suivre la trace des groupes
israélites dans le monde entier. Jusqu’à présent, les indices semblent
désigner l’Europe comme destination principale, en particulier les pays de
langue germanique et celtique de la Scandinavie, de Grande-Bretagne et du
continent européen.
Le rassemblement
d’Israël
Le rôle que les descendants
d’Abraham allaient jouer dans le cours de l’histoire du monde a été
préfiguré dès le début des annales bibliques. Le Seigneur a dit à Abraham
: « Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations; et des
rois sortiront de toi » (Ge 17:6).
Le Seigneur a renouvelé la
promesse à Isaac (voir Ge 26:4) et aussi à Jacob, disant que ses
descendants se répandraient « à l’occident et à l’orient, au septentrion
et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en
ta postérité » (Ge 28:14).
Cette diffusion se produirait
comme prédit par Moïse : Israël serait un jour dispersé « parmi les
peuples » et il n’en resterait « qu’un petit nombre au milieu des nations
où l’Éternel [les] emmènera[it] » (De 4:27). Ce serait une dispersion
totale. Comme le Seigneur le dit dans Amos 9:9 : « Je secouerai la maison
d’Israël parmi toutes les nations. » Mais il a également promis qu’il
n’oublierait pas Israël. Les enfants d’Israël finiraient par être «
rassemblés de tous les pays, de l’orient et de l’occident, du nord et de
la mer » (Ps 107:3).
Israël devait être dispersé
dans le monde entier, mais les pays au nord d’Israël étaient
particulièrement désignés comme étant les pays d’où Israël serait
rassemblé. Jérémie écrit : « C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel, où l’on ne dira plus: L’Éternel est vivant, lui qui a fait
monter du pays d’Égypte les enfants d’Israël! Mais on dira: L’Éternel est
vivant, lui qui a fait monter les enfants d’Israël du pays du septentrion
et de tous les pays où il les avait chassés! » (Jé 16:14-15 ; voir aussi
D&A 110:11 ; 133:26).
Il n’est pas étonnant que
Jésus ait envoyé ses apôtres dans le monde entier prêcher l’Évangile (voir
Marc 16:15) ou qu’il ait dit qu’ils devaient aller « vers les brebis
perdues de la maison d’Israël » (Mt 10:6).
Les populations d’Israël sont
maintenant dispersées depuis longtemps. Autant que nous le sachions, une
partie seulement de Judas a conservé son identité au cours des siècles.
Avec le rétablissement de l’Évangile par l’intermédiaire de Joseph Smith,
le prophète, beaucoup de membres qui ont reçu leur bénédiction patriarcale
ont été identifiés aux tribus d’Éphraïm, de Manassé et à un saupoudrage
d’autres tribus. Il est également significatif que, parmi les premiers à
accepter l’Évangile dans notre dispensation, il y a eu des personnes qui
vivaient, ou avaient des ancêtres qui vivaient dans les pays mêmes qui ont
reçu des migrations Israélites.
Voir leurs traces
Les changements de langue ne
constituent qu’une espèce d’éléments de preuve linguistique que nous
pouvons utiliser pour identifier la dispersion d’Israël. On peut trouver
d’autres preuves linguistiques dans les noms de lieux et dans les noms de
divers peuples anciens qui vivaient au nord du Proche-Orient après la
captivité d’Israël. Beaucoup de ces peuples ont émigré plus loin vers le
nord et l’ouest en Russie, en Scandinavie, en Europe et en
Grande-Bretagne.
Le livre apocryphe de 4 Esdras
(suite du livre d’Esdras dans l’Ancien Testament) décrit comment
Salmanasar, roi d’Assyrie, réduisit Israël, le royaume du nord, en
captivité. Il laisse aussi entendre, comme prophétisé par Ésaïe (voir
Ésaïe 10:27), que quelques-uns au moins des Israélites échappèrent à leurs
conquérants et s’enfuirent vers le nord.
Selon le récit de 4 Esdras
(que certaines éditions appellent 2 Esdras), les prisonniers « entrèrent
dans l’Euphrate par le passage étroit du fleuve » et voyagèrent pendant un
an et demi dans une région appelée « Arsareth » (4 Esdras 13:43-45). Le
passage étroit pourrait être le col de Dariel, également appelé le col
caucasien, près de la source de l’Euphrate, qui se dirige vers le nord à
travers les monts Caucase. Au début du siècle dernier, l’archéologue russe
Daniel Chwolson a noté qu’une crête de montagne longeant ce passage étroit
porte l’inscription Wrate Israila, qu’il interprète comme voulant dire «
les portes d’Israël » [19].
Ce passage étroit traverse une
région appelée Ararat en hébreu et Urartu en assyrien. Chwolson écrit que
l’Arsareth mentionnée dans 4 Esdras était un autre nom d’Ararat, une
région s’étendant jusqu’aux rivages septentrionaux de la mer Noire [20].
Un fleuve situé dans le coin nord-ouest de la mer Noire était autrefois
appelé Sereth (maintenant Siret), conservant peut-être une partie du nom
Arsareth. Étant donné que ‘ar en hébreu signifiait « ville », il est
probable qu’Arsareth était une ville, la ville de Sareth, située près du
fleuve Sereth au nord-ouest de la mer Noire.
Un certain nombre d’autres
emplacements géographiques dans la région de la mer Noire ont des noms qui
font penser à des origines hébraïques. Par exemple, les noms des quatre
cours d’eau principaux qui se déversent dans la mer Noire semblent avoir
des liens linguistiques avec le nom tribal de Dan. Il s’agit du Don (et de
son affluent, le Donets), le Dan-jester (maintenant Dniestr), le Danube
(ou Donau) et le Dan-jeper (maintenant Dniepr). Au nord de la mer
Caspienne, il y a une ville appelée Samara (Samarie). Il y a aussi une
ville appelée Ismaïl (Ismaël) sur le Danube et un peu plus en amont, il y
a une ville appelée Isak (Isaac).
Chwolson et d’autres membres
de la société archéologique de Russie ont trouvé plus de sept cents
inscriptions hébraïques dans la région au nord de la mer Noire. Selon
Chwolson, une de ces inscriptions appelle la mer Noire « mer d’Israël »
[21]. Dans la péninsule de Crimée, il y avait un endroit appelé « vallée
de Josaphat », un nom hébreu, et un autre endroit était appelé «
forteresse d’Israël » [22]. Selon l’archéologue russe Vsevolod Mueller, il
y avait une synagogue « israélite » à Kerch (ville de Crimée) longtemps
avant l’ère chrétienne [23].
Il est difficile de dater ces
inscriptions, mais certaines d’entre elles contiennent des informations
relatives à la chute et à la captivité d’Israël. D’autres semblent avoir
été écrites à peu près à l’époque du Christ et même plus tard, ce qui
indique que la région au nord de la mer Noire a abrité une population
israélite pendant de nombreux siècles. Une de ces inscriptions mentionne
trois des tribus d’Israël ainsi que Tiglath-pileser, premier roi d’Assyrie
à déporter des tranches importantes de la population d’Israël en Assyrie
[24]. Une autre inscription mentionne le roi Osée, qui régna en Israël
pendant les années de la chute de celui-ci [25].
Les archéologues russes ont
également trouvé des tertres, ou tas de terre, parsemant le paysage [26].
Ces tertres, qui s’étirent sur toute la région au nord de la mer Noire où
les inscriptions hébraïques ont été trouvées, se sont révélés être des
chambres funéraires complexes, contenant souvent un dirigeant du peuple
avec quelques-uns de ses biens. Bien que la construction de tertres ne
soit pas typique des enterrements au Proche-Orient, plusieurs passages de
l’Ancien Testament utilisent l’expression « grand monceau » comme moyen
d’ensevelissement. (Voir Jos 7:26, 8:29, 2 Sa 18:17.) En outre, il fut
explicitement commandé aux gens d’Éphraïm, dans l’Ancien Testament, de
dresser des signes et de placer des poteaux au cours de leur voyage (voir
Jé 31:21).
Ces tertres de la mer Morte
contiennent non seulement des inscriptions mais aussi des dessins, des
bijoux et d’autres objets d’origine hébraïque. Les tertres s’étendent de
la mer Noire vers le nord à travers la Russie jusqu’au sommet de la
péninsule scandinave, puis vers le sud jusque dans le sud de la Suède, où
l’on en trouve des milliers [27]. On trouve aussi des tertres funéraires
du même genre en Grande-Bretagne et en Europe occidentale, révélateurs
d’autres émigrations en direction de l’ouest et du nord-ouest.
Hérodote a appelé les premiers
bâtisseurs de tertres de la région de la mer Noire Kimmerioi [28].
Les Romains les ont appelés Cimmerii, dont nous avons tiré le nom
Cimmériens. Ils se donnaient le nom de Khumri, qui désigne « la
dynastie du roi Omri ». Omri a été roi d’Israël vers 900 av. J.-C. Il a
fondé Samarie et y a installé la capitale d’Israël. Son mode de
gouvernement l’a rendu populaire dans tout le Proche-Orient et il a fini
par donner politiquement son nom, à partir de ce moment-là, au royaume du
nord, ou Israël.
Il y a, dans toute l’Europe et
en Asie, d’autres peuples dont les origines remontent à cette région et
dont les noms semblent avoir une racine hébraïque. Parmi eux il y a les
Galadi (la racine vient probablement du Galaad biblique, la
région située à l’est du Jourdain, prononcée Galaad dans cette région et
en Assyrie et les Celtes (prononciation germanique de Galadi); les
Gallii (ou Gali, racine dérivant probablement du biblique Galilée)
et également appelés Gals, Gaels et Gaulois; les
Sacites, ou Scythes (le mot vient des captifs Assyriens,
Esak-ska et Saka, que l’on peut comparer à l’hébreu Isaac);
les Goths, ou Getai (la racine vient probablement du Gad
biblique, prononcé Gath); les Jutes du Jutland (d’après la
tribu de Juda) et les Parsi (de l’hébreu Paras, qui
signifie « les dispersés »), qui ont colonisé Paris et dont le nom, dans
les territoires germaniques, s’est transformé en Frisons.
NOTES
[1] Terry M. Blodgett est
professeur de langues et de linguistique à la Southern Utah University où
il enseigne la langue, la littérature et l’histoire allemandes et
l’hébreu.
[2] Cet article est basé sur
la thèse de doctorat de l’auteur « Phonological Similarities in Germanic
and Hebrew », Université d’Utah, 1981 et des études postérieures.
[3] Voir John T. Waterman, A History of the
German Language, Seattle, University of Washington Press, 1966, p. 28 ;
Heinz F. Wendt, dir. de publ., Sprachen in das Fisher Lexicon, Francfort/Main,
Fisher, 1977, p. 101 ; et R. Priebsch et Collinson, The German Language,
Londres, Faber, 1966, p. 69 ; voir aussi pp. 58-70.
[4] On trouvera la description
détaillée de la première mutation consonantique germanique dans Waterman,
A History, p. 24 ; Priebsch et Collinson, The German Language, pp. 58-70 ;
ou Wendt, Sprachen, p. 101.
[5] Voir W. B. Lockwood, Indo European
Philology, Londres, Hutchinson, 1969, p. 123.
[6] On trouvera le résumé de
ces théories dans Waterman, A History, pp. 28-29 et Priebsch et Collinson,
The German Language, p. 68.
[7] Dans cet article, nous
avons adopté la convention des linguistes professionnels de mettre entre
crochets les groupes de sons apparentés.
[8] Voir Waterman, A History, p. 28 ; Wendt,
Sprachen, p.. 101 ; et Priebsch et Collinson, The German
Language, p. 69.
[9] Ces sons n’existaient pas
dans la langue indo-européenne originelle. Ils sont entrés, au cours de
cette même période, dans le germanique, l’arménien, le grec, le celtique,
le perse et, dans une moindre mesure, dans plusieurs autres langues.
[10] La même exception aux
règles de la gémination est également apparue dans les deux langues. Le r
(et les fricatives gutturales) n’était doublé ni en hébreu ni en
germanique ; au lieu de cela, la voyelle précédant le r s’allongeait,
comme dans l’hébreu berakh (« bénir ») et le vieil anglais heran (« hear
», entendre).
[11] Voir William Chomsky, Hebrew : The
Eternal Language, Philadelphie, Jewish Publication Society of America,
1957, pp. 55-56. Wilhelm Gesenius fait souvent allusion
aux survivances d’autres cas en hébreu. Voir ses œuvres, Geschichte
der hebräischen Sprache und Schrift, Hildesheim, Olms, 1973, et Hebrew-Chaldee
Lexicon of the Old Testament Scriptures, trad. Samuel Tyregeles, Grand
Rapids, Michigan, Baker Book House, 1979.
[12] On trouvera les détails
dans Blodgett, « Phonological Similarities », pp. 73-76.
[13] Voir Lockwood, Indo European Philology,
p. 123.
[14] On trouvera le détail des
différences dans Blodgett, « Phonological Similarities », pp. 58-72.
[15] Voir « Hebrew Language », The Jewish
Encyclopedia, New York, KTAV, 1964, 7 :308 ; également Néhémie 13:24.
[16] Voir Alexis Muston, Israel of the Alps :
A Complete History of the Waldenses and Their Colonies, 2 vol., New York,
AMS Press, 1978.
[17] Voir « Aramaic »,
Encyclopedia Judaica, 16 vols., Jérusalem, Keter, 1971, 3:262-266.
[18] Voir Chomsky, Hebrew, pp.
92, 112. L’araméen a aussi commencé à changer le [d] en [dh], mais Chomsky
n’en parle pas, peut-être parce que les Juifs n’ont pas adopté d’une
manière aussi systématique cet aspect de la mutation.
[19] Izvestia o Chozarach i
Russkich, cité et traduit par Joseph C. Littke dans Utah Genealogical and
Historical Magazine, janvier 1934, pp. 7-8.
[20] Idem
[21] Idem, p. 8.
[22] William H. Poole, The Saxon Race,
Toronto, Briggs, n.d., p. 452.
[23] Materialy dlia isoutchenia
Evreikago-Tatarskago yazyka, Saint-Pétersbourg, n.p., 189, cité par Littke
dans Utah Genealogical and Historical Magazine, p. 8.
[24] Chwolson, Pamiatniki drevnei pismennosti,
Saint-Pétersbourg, n. p., 1892, cité par Littke dans Utah Genealogical and
Historical Magazine, p. 9.
[25] Idem.
[26] On trouvera des informations concernant
ces tertres dans Russian Antiquities, livre 1, Copenhague, n. p., 1850 ;
The History of Herodotus, trad. George Rawlinson, dans Great Books of the
Western World, 54 volumes, Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1952, 6:126
; Heinrich Schurtz, « The Scythians, Cimmerians and Sarmatians », The Book
of History, 18 volumes, New York, the Grolier Society, 1915-1921,
6:2443-2450 ; et Paul B. Du Chaillu, The Viking Age, New York, Charles
Scribner’s Sons, 1889, pp. 216, 299.
[27] Idem.
[28] George Rawlinson,
trad., History of Herodotus, dans Great Books, 6:126.
|